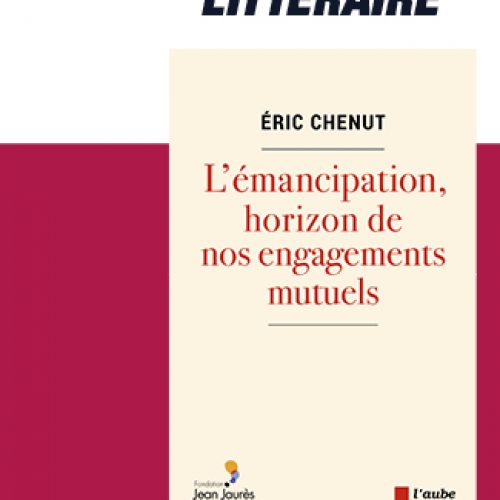Dossier

Par Anaïs Fossier
Responsable des études du CRAPS
Le 26 septembre, le gouvernement présente – sur fond de crise sanitaire, d’inflation et de reconfiguration des équilibres politiques à l’Assemblée – le premier budget social du second quinquennat d’Emmanuel Macron. L’heure n’est plus « à panser les plaies mais à préparer l’avenir » explique l’exécutif, saluant un texte « d’engagement et d’investissement pour notre système de santé » qui devrait être enrichi par les parlementaires et les concertations menées dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR). Le 20 octobre, comme attendu, les débats débutent dans un climat houleux à l’Assemblée. Sans suspense, Élisabeth Borne met un terme aux discussions en fin d’après-midi en engageant la responsabilité de son gouvernement sur la partie « recettes » du projet de loi en recourant à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Si les débats en commission « pour la plupart très constructifs » ont permis d’enrichir le texte « avec l’adoption d’amendements de la majorité comme des oppositions », la cheffe du gouvernement déplore le rejet de la première partie du texte par les députés « à rebours de la commission ».
La présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui appelait en premier lieu à « prendre le temps du débat », rappelle quant à elle que le recours à l’article 49 alinéa 3 est nécessaire pour respecter les délais constitutionnels impartis. Quatre jours plus tard, après le rejet de la motion de censure déposée par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), la partie « recettes » du projet de budget est adoptée sans vote en première lecture. Le 26 octobre, Élisabeth Borne engage une nouvelle fois, là encore sans surprise, la responsabilité du gouvernement sur l’ensemble du texte et notamment sur la partie « dépenses ». Dénoncé comme un passage en force, cet acte d’autorité – alors que les enjeux de santé et plus largement de protection sociale appellent un débat approfondi – passe mal.
Finalement, « ce rendez-vous qui devait être majeur pour débattre des grandes priorités de santé peine à tenir ses promesses », regrette Lamine Gharbi, président de la fédération de l’hospitalisation privée (FHP). Alors que la Première ministre promettait un « changement de méthode » de travail avec le Parlement, la stratégie interroge. Le 31 octobre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Pour les oppositions, la pilule est amère.
« Nous mettons beaucoup d’argent dans la santé, mais nous n’en avons pas pour notre argent »
Après un soutien financier massif et constant pendant près de trois ans, le gouvernement anticipe un déficit de la Sécurité sociale de 7,3 milliards d’euros1 pour 2023. Une très nette amélioration par rapport à l’année 20222 qui repose cependant essentiellement sur « une hypothèse optimiste qui est celle de la division par 10 des dépenses exceptionnelles d’Assurance maladie dues à la crise sanitaire », alerte le Haut Conseil des finances publiques. Le gouvernement, qui semble miser sur la fin de la pandémie, n’a en effet provisionné qu’un seul milliard d’euros pour faire face à la Covid-19 (contre 11,5 milliards d’euros en 20223). Si cette réduction drastique du déficit est saluée, il ne s’agirait cependant que d’une embellie de court terme puisque les estimations à compter de 2024 prévoient un creusement du déficit qui devrait alors atteindre près de 12 milliards d’euros en 20264.
Une pérennisation du déficit de la Sécurité sociale qui crée en outre « le risque d’une croissance continue de l’endettement social au détriment des générations futures », alerte à son tour la Cour des comptes. Au final, la lecture de ce projet de loi révèle que la dette est désormais « une des modalités normales et pérennes de financement de la protection sociale » déplore le sénateur (LR) des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin considérant qu’une « stratégie structurelle de réduction des déficits » nous fait cruellement défaut. En résumé, « nous mettons beaucoup d’argent dans la santé, mais nous n’en avons pas pour notre argent ». À l’heure où la question de l’équilibre des comptes sociaux est au cœur du débat public, il est utile de rappeler qu’un déficit permanent ne constitue pas une politique viable sur le long terme. Pour reprendre les mots de l’ancien député (LR) du Loiret, Jean-Pierre Door, il est urgent de « renoncer au poison mortel de cette dette perpétuelle » qui remet en cause la pérennité de notre système de protection sociale, largement conditionnée par un retour à l’équilibre.
Concernant l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), comme à l’habitude très attendu, le gouvernement affiche un objectif « dynamique » pour « accompagner la transformation de notre système de santé et tenir compte du contexte d’inflation ». Voté à 244,1 milliards d’euros pour 2023, l’ONDAM devrait ainsi augmenter de 3,7 % (hors dépenses covid), se félicite l’exécutif. Un objectif qui, pour la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), se révèle cependant « dans un contexte d’inflation dynamique » largement « en deçà des prévisions pour 2023 » et ne tient pas compte de « la hausse tendancielle des besoins de santé estimés à 4 % par la commission des comptes de la Sécurité sociale » s’inquiète Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne (CRCE) et vice-présidente de la commission des Affaires sociales au Sénat.
Trop longtemps considéré comme « une variable d’ajustement pour réaliser des économies, au détriment de sa capacité à réaliser ses missions5 », l’hôpital public bénéficiera quant à lui d’une enveloppe en augmentation de 4,1 %. Ces moyens permettront entre autres de financer les revalorisations du Ségur, les assises de la santé mentale ou encore la hausse du point d’indice dans la fonction publique. Si le gouvernement salue une augmentation historique, la Fédération hospitalière de France (FHF), dont le nouveau président Arnaud Robinet vient de débuter son mandat, alerte sur les risques de dégradation de la situation financière des hôpitaux et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au regard de l’inflation que les crédits alloués (pour 2022 et 2023) « ne sont pas de nature à compenser » et d’une activité hospitalière « toujours inférieure à celle de 2019 ». Plus inquiétant encore pour la fédération, « aucun financement ne semble prévu pour couvrir les mesures de revalorisation telles que les heures supplémentaires ou les gardes » décidées l’an dernier ou lors des différentes vagues Covid6.
Les soins de ville affichent, quant à eux, une progression de 2,9 %. Une enveloppe qui provoque l’ire des libéraux, considérant que cette dernière ignore la nécessité de soutenir les soins de ville. « On nous vend un Ondam exceptionnel » alors qu’il est « déséquilibré par rapport à l’hôpital et surtout pour la première fois il est inférieur à l’inflation », s’indigne le président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), Franck Devulder, rappelant que « les effets tarifaires de la future convention médicale ne s’appliqueront qu’en novembre voire décembre 2023. Or, en 2024, on nous annonce déjà un Ondam à la baisse de l’ordre de 2,6 % alors que l’inflation risque de se poursuivre ». Il ne sera donc, in fine, pas possible « d’engager la réorganisation du système de soins de premier recours qui s’impose aujourd’hui », conclut Pascale Vatel, secrétaire générale de la Fédération des mutuelles de France (FMF).
« Faire de la politique, c’est faire des choix »
Si, après deux ans de crise, aucunes économies ne sont demandées à l’hôpital, c’est que le gouvernement entend ponctionner d’autres secteurs « qui bénéficient de niveaux élevés de rentabilité », explique Gabriel Attal rappelant que « faire de la politique, c’est faire des choix ». Il ne s’agit pas de « stigmatiser certains profits comme indus » mais bien de faire « des efforts là où nous pouvons, si nous voulons permettre à notre système de perdurer », développe le ministre délégué à l’Action et aux Comptes publics. Dans cette optique, le gouvernement entend mettre à contribution le secteur de la biologie médicale en imposant 250 millions d’euros de baisse de tarifs « dans l’hypothèse d’une absence d’accord entre l’Assurance maladie et les biologistes » au motif que « la concentration du secteur et le développement de l’activité ont permis à la biologie médicale d’augmenter sa rentabilité de façon très importante, à hauteur de 23 % en 2020 ».
Si les biologistes se disent favorables à une taxe exceptionnelle pour participer à « l’effort de guerre », la méthode est contestée : « nous nous retrouvons aujourd’hui dans l’œil du cyclone puisqu’il nous est demandé de redonner à l’État les bénéfices non pas sur la Covid mais sur la nomenclature », « cela veut dire qu’à ce moment-là, ce n’est plus une question de santé publique », fustige François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes rappelant que depuis 10 ans la biologie médicale est « une variable d’ajustement ». Chez les radiologues, même logique puisque ces derniers devront négocier avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) un nouveau protocole7 pour juguler la dépense à hauteur de 150 millions en 2023. « Un bien mauvais signal qui rompt le partenariat établi avec l’Assurance maladie et renvoie 20 ans en arrière » déplore la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR).
Pour réduire le déficit de la Sécurité sociale, les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) n’échapperont pas non plus au coup de rabot puisqu’un transfert de charges du régime général à hauteur de 150 millions est prévu pour 2023 (300 millions dès 2024). Un transfert qui impactera fortement « les équilibres économiques des mutuelles, soumises à des obligations prudentielles et réglementaires », regrette la Fédération nationale de la mutualité française. Ces nouveaux transferts, « en plus de l’évolution naturelle des dépenses de santé, du Reste à charge zéro appelé « 100 % santé » et des taxes sur les cotisations mutualistes, vont inévitablement alourdir les cotisations des adhérents des mutuelles », alerte la secrétaire générale de la Fédération des mutuelles de France (FMF).
Du côté des industriels, la colère est immense. Le syndicat des entreprises du médicament (LEEM), à travers une alliance quasi inédite, conteste les économies à hauteur de 1,1 milliard d’euros attendues sur le médicament et le dispositif médical, soit 900 millions d’euros de baisse de prix et 200 millions d’euros issus de la clause de sauvegarde alors même que l’exécutif n’a eu de cesse pendant la crise sanitaire de rappeler le caractère stratégique de l’industrie. Une économie jugée « raisonnable » par le gouvernement puisque « le marché du médicament est en forte croissance, de l’ordre de + 6 % par an ». Le syndicat déplore un PLFSS qui « tourne le dos à l’innovation, sonne le glas des ambitions industrielles de la France et menace à terme l’accès des Français aux médicaments ». Et pour cause : alors que « la dépense réelle en médicaments remboursés des Français en 2022 va être de l’ordre de 26,4 milliards, le budget alloué dans le PLFSS pour 2023 est de 24,6 milliards, soit deux milliards de moins que les besoins », s’inquiète Thierry Hulot, président du LEEM.
Des économies d’autant plus inacceptables que le pays « n’a pas encore surmonté la crise Covid et que les patients peinent à accéder en France aux innovations les plus récentes ». Plus largement, « l’inflation et la politique de prix du gouvernement mettent à mal le modèle de recherche, d’innovation et de production industrielle de l’ensemble des acteurs du secteur », constate le président du LEEM. Face à la fronde du secteur, le gouvernement fait le choix de l’apaisement et décide de battre en retraite sur les points les plus litigieux du projet de loi à l’instar du référencement, mécanisme consistant à sélectionner et rembourser quelques médicaments pour une classe thérapeutique donnée, et donc à dérembourser ceux qui n’ont pas été retenus.
L’idée n’est cependant pas abandonnée puisque le gouvernement se laisse jusqu’à juillet 2023 pour remettre au Parlement un rapport évaluant la faisabilité du dispositif. Rapport qui devra notamment évaluer les effets potentiels de la mesure sur les pénuries de médicaments. Le gouvernement décide dans le même temps de revoir son texte sur la possibilité de modifier la répartition de la clause de sauvegarde, système qui prévoit que les laboratoires versent une contribution à l’Assurance maladie lorsque leur chiffre d’affaires dépasse un niveau fixé par la loi de financement de la sécurité sociale. Le secteur apprécie mais reste sur ses gardes.
« Vingt-cinq ans d’erreurs des gouvernements successifs »
30,2 % de la population vit aujourd’hui dans un désert médical. Une problématique non sans incidence sur la santé des Français puisque chaque année, 1,6 million d’entre eux renonce à des soins et que les délais moyens d’attente pour un rendez-vous médical s’allongent. Du côté des médecins, le constat n’est guère plus réjouissant : 45 % des généralistes sont en situation de burn-out, et, alors que la France n’a jamais compté autant de médecins en exercice, un médecin sur dix à la retraite continue d’exercer, faute de remplaçant. Les prévisions qui se dessinent pour l’avenir sont donc plutôt sombres : si rien n’est fait, dans cinq ans, 27 millions de Français pourraient se retrouver sans médecin généraliste8.
Un constat alarmant qui conduit l’exécutif à proposer de fixer la durée minimale du troisième cycle des études de médecine générale à quatre ans (le nombre d’années d’études passant ainsi de 9 à 10 ans) et à affecter cette année supplémentaire à la réalisation de stages en pratique ambulatoire, en régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. L’ajout de cette phase de « consolidation » devrait par ailleurs permettre de compléter la formation des généralistes qui serait alors alignée sur les autres diplômes d’études spécialisées dans la mesure où « la durée du troisième cycle de médecine générale, qui reste fixée à 3 ans, fait exception », rappelle Corinne Imbert, sénatrice (LR) de Charente-Maritime et rapporteure pour la branche assurance maladie au Sénat. Une durée qui s’avère, à titre de comparaison, plus courte que celle retenue chez certains de nos homologues européens. En Irlande ou en Pologne, les médecins suivent par exemple un troisième cycle de quatre ans, et de cinq ans au Danemark ou encore en Suède.
La réaction des étudiants ne se fait pas attendre, l’appel à la grève est immédiat. L’intersyndicale nationale des internes (ISNI) dénonce une réforme visant à « instrumentaliser les médecins en formation pour répondre à moindres frais aux problèmes d’accès aux soins ». Les carabins peuvent compter sur le soutien du Syndicat des médecins libéraux (SML) estimant que l’ajout de cette année supplémentaire revient à « faire porter sur les épaules de la jeunesse le poids de vingt-cinq ans d’erreurs des gouvernements successifs ». Autre point de crispation : l’ajout d’une quatrième année se heurterait à deux difficultés : le manque de praticiens agréés maîtres de stage des universités (PAMSU) susceptibles de les accueillir en stage ambulatoire et le risque de dégrader un peu plus encore l’attractivité d’une filière déjà fragile (la médecine générale en 2022 se situe en 39e position sur 44 des spécialités préférées des internes9). Il en résulterait ainsi, selon les étudiants, une plus grande difficulté d’accès aux soins.
Pour rappel, entre 2010 et 2021, la France est passée de 62 000 à 57 000 praticiens dans la spécialité. La baisse est encore plus conséquente lorsqu’elle est rapportée à la population : la densité médicale des généralistes a diminué de 18 % sur 20 ans lorsqu’elle ne diminuait que de 9 % pour les autres spécialités sur la même période10. Face à la contestation grandissante, le ministre de la Santé pour apaiser les esprits se veut rassurant : cette année supplémentaire a vocation à être consacrée à des stages ambulatoires pour mieux préparer l’exercice en cabinet médical, en priorité en zones sous-denses mais reste sur la base du volontariat. Il y a donc fort à parier que cette mesure ne produise pas les effets escomptés, explique le sénateur (SER) du Finistère, Jean-Luc Fichet, puisque « si les internes ne veulent pas y aller, ils n’iront pas ! Finalement, rien ne changera ».
Face au spectre de la désertification médicale, la question de la liberté d’installation cristallise comme chaque année le débat. Si de plus en plus de voix s’élèvent en faveur de la coercition, François Braun rappelle son opposition sur le sujet « pas par dogme, mais parce que ça ne marche pas ». Une ligne que partage le député (DEM) du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille, considérant que « la seule solution est de rendre la médecine libérale plus attractive ». Il apparaît alors nécessaire d’adopter une approche plus globale des enjeux pour inciter les futurs médecins à s’installer dans ces Territoires. La réponse doit être multiple au regard des attentes des jeunes générations de médecins et doit notamment concerner l’aménagement du territoire (politique du logement, des transports…). Le défi est grand, la tâche complexe. Finalement, « augmenter l’offre de soins et améliorer sa répartition sur le territoire passe à la fois par des politiques d’incitation à l’installation et par des politiques de soutien aux professionnels exerçant dans des zones défavorisées11 ».
Concernant les maîtres de stages – en sous-effectif – le ministre se veut optimiste et affirme que les postes d’enseignants en médecine générale seront augmentés et que tous les moyens seront mis en œuvre pour que « cette quatrième année soit vraiment une année professionnelle ». Un optimisme que relativise Paul-André Colombani, député (LIOT) de Corse-du-Sud et membre de la commission des Affaires sociales à l’Assemblée, estimant que la réforme qui entrera en vigueur en 2026 ne permettra pas de réunir les 4 000 maîtres de stages manquants aujourd’hui. En outre, « un médecin qui exerce dans une région isolée et qui a déjà du mal à trouver un remplaçant pour une semaine de vacances ne prendra pas sur son temps médical pour aller se former ». De toute évidence, cette quatrième année suscite bien des passions mais a peu de chance d’aboutir dans le cadre de ce projet de loi, tempère le sénateur (LR) des Deux-Sèvres et vice-président de la commission des Affaires sociales, Philippe Mouiller, considérant que cette mesure de formation et non de financement constitue un cavalier social qui sera certainement invalidé par le Conseil constitutionnel.
Le texte prévoit par ailleurs – à défaut d’avoir des médecins en nombre suffisant sur l’ensemble du territoire les soirs et les week-ends – que la permanence des soins soit étendue aux infirmiers, sages-femmes et dentistes. De surcroît, un infirmier justifiant d’une formation avancée pourra, à titre expérimental pendant trois ans sur certains Territoires, prendre en charge directement des patients. Le texte instaure ainsi un principe de « responsabilité collective » dans la participation à la permanence des soins, que ce soit en ville ou en établissement, avec la volonté que les Français puissent bénéficier d’un « accès aux soins non programmés en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d’un territoire ». La permanence des soins ne doit en effet pas seulement reposer sur l’hôpital public ou les médecins, défend Stéphanie Rist, rapporteure générale de la commission des Affaires sociales, estimant que dans un contexte de « démographie médicale en tension, de vieillissement de la population et d’émergence de nouveaux risques, il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur les compétences de l’ensemble des professionnels de santé tout en les faisant évoluer ». De son côté, le Sénat, considérant que le PLFSS « ne constitue pas un véhicule approprié pour des mesures touchant de manière si structurante à l’organisation du parcours de soins et aux répartitions de compétences », appelle de ses vœux une véritable loi de santé permettant une réflexion globale sur ce sujet.
« Nous ne pouvons pas proposer les mêmes dispositifs à toute la population »
Si la France a historiquement privilégié un système de soins au détriment de la prévention, le texte traduit une volonté de changer de logiciel. Il est ainsi prévu que des bilans de santé complets et pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie à 25, 45 et 65 ans soient mis en place pour lutter contre « l’apparition de risques ou de pathologies à ces trois périodes clés de la vie » en complément des campagnes de dépistage et de vaccination existantes et des 20 examens de santé de l’enfant et de l’adolescent. Ces rendez-vous porteront entre autres sur le besoin d’activité physique, la santé des femmes ou encore la perte d’autonomie et devront permettre de repérer « des violences sexistes et sexuelles ».
Le contenu et modalités de leur mise en œuvre ne sont pas encore connus, mais plusieurs problématiques sont d’ores et déjà identifiables : quelle sera la capacité des médecins à absorber cette nouvelle demande dans un système sous tension, où la ressource en soins primaires se raréfie ? Comment convaincre les Français de se rendre à ces rendez-vous alors que les programmes nationaux de prévention relatifs à la vaccination ou au dépistage peinent à emporter l’adhésion, comme le montre par exemple le faible taux de dépistage du cancer coloréctal12 de l’ordre de 30 % alors qu’il s’agit de la deuxième cause de décès par cancer chez l’homme ?
Si tous les acteurs partagent de surcroît le constat qu’un véritable virage préventif doit être opéré, la pertinence des mesures ciblant l’ensemble de la population est interrogée. Les travaux scientifiques et les comparaisons internationales semblent en effet montrer que « le ciblage des profils à risque ou des moments de rupture, comme le chômage ou la retraite, sont des variables plus pertinentes que de simples bornes d’âge pour des bilans de santé à caractère général », détaille Corinne Imbert. François Alla, chef de service au CHU de Bordeaux, ne cache pas non plus son scepticisme : « La consultation de prévention à un âge cible, c’est une fausse bonne idée… les données scientifiques montrent clairement son absence d’efficacité en population générale. »
De plus, « si proposer des visites gratuites va dans le bon sens, nous en connaissons déjà les limites », explique le professeur Olivier Saint-Lary, président du Collège national des généralistes enseignants, puisque « ce sont toujours les mêmes patients, autrement dit ceux déjà bien suivis, qui en tirent les bénéfices ». L’enjeu consiste, à cet égard, à « aller vers » comme ce fut le cas notamment pour la vaccination contre la Covid-19. Pour ce faire, les actions et les messages de prévention doivent être personnalisés. Si nous voulons que la prévention bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin, « nous ne pouvons pas proposer les mêmes dispositifs à toute la population, sinon ceux qui en ont le moins besoin se les approprieront toujours le mieux alors que les personnes très éloignées du système n’en bénéficieront que peu », alerte Franck Chauvin, ancien président du Haut Conseil de la santé publique. En résumé, une mesure de prévention, pour être efficace, doit s’inscrire dans le cadre d’une approche populationnelle pour que les personnes à risque puissent être repérées et que les inégalités sociales et géographiques face à la maladie soient prises en compte.
Le projet de loi prévoit pour le reste, la prise en charge à 100 % pour les moins de 26 ans du dépistage sans ordonnance des infections sexuellement transmissibles (autres que le VIH) en forte recrudescence. Une évolution inquiétante, compte tenu de la multirésistance aux antibiotiques qui se développe et augmente le risque d’impasse thérapeutique. Autre évolution notable, alors que nous assistons à une montée préoccupante des conservatismes à l’encontre des droits des femmes dans le monde et notamment en Europe, « le gouvernement démontre que le droit des femmes à disposer de leurs corps est une priorité absolue », se félicite Isabelle Rome, ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, alors que le nombre d’interruptions volontaires de grossesses (IVG) reste à un niveau élevé (en 2021, 223 300 IVG ont été pratiquées), le texte étend la gratuité de la contraception d’urgence à toutes les femmes sans condition de prescription médicale. Une mesure qui devrait, selon la Direction de la Sécurité sociale (DSS), « décupler le coût de la pilule d’urgence pour l’État de 1,6 à 16 millions d’euros par an13 ».
Ces évolutions s’inscrivent dans la continuité du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2022 qui prévoyait déjà une prise en charge de la contraception jusqu’à 25 ans et la gratuité du dépistage du VIH sans ordonnance. Si les différentes mesures envisagées pour développer la prévention vont dans le bon sens, celles-ci sont loin de dessiner une révolution de la prévention : « ni financièrement, ni du point de vue de l’organisation du système, le virage préventif n’est pris », déplore la mutuelle de France Unie. L’on constate plus globalement que l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie ne permet pas d’adopter une véritable vision pluriannuelle nécessaire pour une politique de prévention efficace.
« Les vieux méritent mieux ! »
Après trois quinquennats d’espoirs (toujours déçus) sur les politiques du grand âge, malgré la succession de nombreux rapports faisant tous état de l’urgence d’agir, les attentes restent fortes en la matière. Le 26 juillet dernier, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, affiche la couleur : « plutôt qu’une grande loi, je pense que ce qui est urgent aujourd’hui c’est d’agir. » Pas de grande loi en prévision, donc, mais le ministre promet un PLFSS « ambitieux à la hauteur des enjeux ». Pour 2023, l’objectif de dépenses de la branche autonomie s’élèvera ainsi à 37,3 milliards d’euros (en augmentation de 5,3 % par rapport à l’année précédente). Les dépenses prévisionnelles au titre du financement des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) atteindraient quant à elles 30 milliards d’euros en 2023 (en hausse de 6 % par rapport à 2022). Une dynamique « positive et nécessaire pour faire face aux enjeux de 2023 mais insuffisante au regard des défis à relever à l’horizon 2030 », constate la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Le gouvernement entend par ailleurs favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Pour ce faire, le texte prévoit de renforcer les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) avec la réforme de la tarification. Le gouvernement s’engage ainsi à relever, par décret, le tarif plancher de l’aide à domicile réalisée par un service autonomie à domicile prestataire, de 22 à 23 euros par heure en 2023. « Si on y ajoute les 3 euros de dotation complémentaire pour la qualité, on arrive à 26 euros, et on se rapproche du prix de revient des services », estime Olivier Richefou, président (UDI) du groupe Grand âge à l’Assemblée des départements de France (ADF). Un calcul qui ne convainc pas les fédérations de l’aide à domicile qui dénoncent un effort largement insuffisant puisque « cela compenserait à peine l’inflation », estime la Fédération française des services à la personne et de proximité (Fedesap). Pour l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (Una), il est « impossible de rester sur un tarif horaire à 22 ou 23 euros, qui en plus comprend les frais de structure, d’évaluation initiale, de coordination du parcours », affirme sa présidente Marie-Reine Tillon, soulignant au passage que la « dotation qualité de 3 euros complémentaires » est « laissée à la discrétion des départements, ce qui crée à nouveau des disparités ».
Côté Ehpad, 3 000 postes de soignants supplémentaires sont prévus pour 7 500 Ehpad (moins d’un poste pour trois établissements), soit seulement 1 000 ouvertures supplémentaires par rapport au PLFSS 2022. Bien loin du rythme de recrutement de 50 000 nouveaux postes sur 5 ans promis par le président de la République. Pour rappel, le rapport El Khomri remis au gouvernement en 2019 estimait que « outre l’augmentation du nombre de personnes en perte d’autonomie, la nécessité d’augmenter les taux d’encadrement et les temps collectifs à domicile et les départs à remplacer, ce sont plus de 350 000 professionnels qu’il faudrait former d’ici 2025 dont plus de 92 000 postes à créer ». Cette première étape « justifiée par la nécessité de fixer un objectif crédible à un secteur qui rencontre des difficultés pour recruter… cristallise la situation », constate Philippe Mouiller, vice-président de la commission des Affaires sociales au Sénat estimant que le recrutement de ces 3 000 personnes supplémentaires « ne provoquera ni une mobilisation générale en faveur de la résolution des problèmes rencontrés par le secteur ni une modification des dispositifs de formation professionnelle en direction du secteur ».
Alors que la France comptera près de 20 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en 2030, les Ehpad ne seraient pas en mesure d’affronter la transition démographique en cours comme en témoigne une enquête éclairante réalisée auprès des 1 400 adhérents de la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées, (Fnadepa) : 89 % des directeurs affirment faire face à un manque de personnel. Une problématique qui n’est pas sans conséquences puisque, de ce fait, près de la moitié des établissements (46 %) fonctionnent actuellement en mode dégradé. « La situation est dramatique ». « Les vieux méritent mieux ! Nous alertons depuis des années sur cette situation, mais nous avons le sentiment de n’être jamais entendus, jamais prioritaires », fulmine Jean-Pierre Riso, président de la Fédération.
L’on constate finalement que rien n’est prévu dans ce texte « pour répondre au vieillissement de la population et au besoin d’accompagnement croissant. Nous sommes assis sur une bombe à retardement… et nous regardons ailleurs » alerte Yannick Neudeur, député (LR) de l’Isère. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) insiste quant à elle sur la nécessité d’agir « dès aujourd’hui pour répondre aux enjeux de demain » et de s’atteler rapidement à « la construction d’une loi définissant les orientations nationales et une trajectoire pluriannuelle pour la politique de soutien à l’autonomie en direction des personnes âgées ou en situation de handicap permettant la projection des moyens appelés par la transition démographique et les besoins de la société inclusion à l’horizon 2030 ».
« Première lecture au Sénat : après ces débats tronqués… faire vivre des débats complets »
Le 7 novembre, les sénateurs débutent l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans un contexte particulier puisque pour la première fois depuis 30 ans14 le projet a été adopté en première lecture à l’Assemblée par l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Élisabeth Doineau, rapporteure générale du projet de loi, en appelle alors à la responsabilité de la Haute Assemblée « après ces débats tronqués de faire vivre des débats complets » regrettant au passage un texte sans « mesures nouvelles majeures » sans aucune « information sur les réformes à venir » finalement, « sans aucune ambition ». Le 15 novembre, le Sénat adopte le projet de loi en première lecture. Cette année encore les équilibres budgétaires n’ont pas convaincu les sénateurs qui décident de supprimer la trajectoire financière de la Sécurité sociale pour 2023-2026. Le niveau de dépenses de santé proposé pour 2023 est également rejeté en raison d’un objectif jugé « difficile à garantir au regard notamment des contraintes qui pèsent sur les établissements de santé ».
Comme à l’habitude, les sénateurs remanient largement le texte. La majorité sénatoriale entend ainsi « apporter des solutions là où le gouvernement hésite et peine à reformer le pays ». Constant sur le sujet, le Sénat propose donc une réforme des retraites (précédée d’une période de négociations qui devrait prendre en compte la pénibilité, les carrières longues et l’emploi des seniors). La droite, en cas d’échec des négociations, prévoit ainsi un allongement de la durée de cotisation et un report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Une véritable aubaine pour le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui y voit la possibilité de trouver une majorité pour faire adopter la réforme qui sera présentée début 2023. Concernant les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), les sénateurs prévoient une « contribution de solidarité » à hauteur de 300 millions d’euros pour financer la Caisse nationale d’assurance maladie. Une mesure qui provoque colère et incompréhension des complémentaires.
Si la mutualité française se dit en effet favorable « à un juste partage des efforts de financement de la protection sociale notamment avec la Sécurité sociale, celle-ci doit nécessairement servir l’accès aux soins et répondre aux besoins de santé de demain », une telle taxation viendrait au contraire s’ajouter aux transferts de charges déjà prévus par le gouvernement et se traduirait « par une augmentation de la fiscalité pesant sur les contrats santé faisant ainsi passer la taxation des contrats responsables de 13,27 % actuellement à 14,07 % en 2024 ». Au final, cette taxation aura des répercussions sur les cotisations au détriment des adhérents « sans tenir compte des populations les plus fragiles ou qui ne bénéficient d’aucun mécanisme de contribution par l’employeur ou d’aide fiscale ». Une proposition controversée qui « soulève des difficultés » tant sur le montant que sur la méthode, reconnaît Olivia Grégoire, ministre des PME.
Les sénateurs se sont par ailleurs largement opposés au transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf15 (donc à l’État) prévu par le projet de loi pour 2024 en votant le retrait de la mesure du texte. Pour rappel, le transfert de la collecte des cotisations Agirc-Arrco s’inscrit dans une logique de simplification et d’amélioration de la performance du recouvrement ainsi que de la réduction des coûts de gestion. Cette mesure avait suscité (et suscite encore) de vives oppositions des Partenaires sociaux – du Medef à la CGT – aux parlementaires tous groupes politiques confondus. Nombreux sont ceux qui dénoncent « un nouveau pas vers l’étatisation de la Protection sociale16 ». « Derrière cette réforme présentée comme technique, se cache une réforme des retraites qui ne dit pas son nom. Le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire par l’Urssaf pourrait permettre à l’État impécunieux de capter les réserves du régime pour en financer d’autres », prévient le sénateur (LR) de la Vendée, Bruno Retailleau.
Une vision partagée par Brigitte Pisa, représentante de la CFDT et vice-présidente du conseil d’administration de l’Agirc-Arrco, considérant que « le sujet c’est de capter 80 milliards d’euros de ressources annuelles plus éventuellement les 60 milliards d’euros de réserve de l’Agirc-Arrco ». « C’est le casse du siècle. On pique l’argent là où il est pour boucher les trous. » D’un point de vue plus technique, les Urssaf « ne sont pas en mesure d’assumer, comme l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs, salarié par salarié » affirme Alain Milon, sénateur (LR) du Vaucluse et vice-président de la commission des Affaires sociales, considérant par ailleurs que l’unification de la collecte ne se justifie plus « dès lors que le projet d’instauration d’un système de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le gouvernement ». Plus largement, enterrer le paritarisme « dans un pays fracturé comme l’est la France aujourd’hui, céder aux sirènes du « tout État » serait une grave erreur17 ».
« Le monde de la santé est en rébellion »
Le 21 novembre, Élisabeth Borne active – après 3 heures de débat – une nouvelle fois sans surprise, l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter la partie « recettes » du projet de loi. « Alors que la nouvelle lecture devait commencer en séance, près de 700 amendements ont été déposés, en plus de ceux adoptés en commission. Nous ne pouvons pas perpétuellement rejouer des débats qui ont déjà été tranchés », estime la cheffe du gouvernement justifiant ce recours au 49.3 afin de ne pas « menacer le calendrier prévu pour l’examen du texte ». Le projet sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité rétablit largement le projet de loi tel qu’il a été adopté à l’issue de la première lecture et ne contient « que des modifications limitées », précise Élisabeth Borne.
Côté hôpital, le gouvernement revoit à la hausse de quelque 500 millions d’euros pour 2022 l’enveloppe accordée au secteur hospitalier pour « compenser les surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19 pour les établissements de santé » et promet de sécuriser le financement des hôpitaux en 2023. Cette rallonge s’ajoute à celle, d’un peu moins de 600 millions d’euros déjà actée au Sénat, pour amortir les difficultés engendrées par l’épidémie de bronchiolite qui fait rage dans les hôpitaux. Le 25 novembre, Élisabeth Borne recourt de nouveau à l’article 49 alinéa 3 sur la partie « dépenses » et sur l’intégralité du texte, précisant que si « monter à cette tribune pour engager la responsabilité de mon gouvernement n’est jamais un acte banal, nous avons un devoir de cohérence et un devoir de résultats ». La messe est dite. Le 29, le Sénat examine en nouvelle lecture le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Les débats sont brefs puisque le jour même une « motion préalable », à l’initiative d’Élisabeth Doineau considérant que la navette parlementaire « ne servirait plus à grand-chose », est adoptée. Une motion qui traduit des désaccords « sur le fond et sur la méthode ».
Finalement, « ni la partie recettes, ni la branche maladie n’auront fait l’objet d’un quelconque débat en séance publique à l’Assemblée lors de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale en première lecture comme en nouvelle lecture », déplore la rapporteure générale. Sur le fond, « ce PLFSS ne tire aucunement les leçons de la pandémie de Covid-19 », note, quant à lui, Bernard Jomier, sénateur (SER) de Paris et vice-président de la commission des Affaires sociales au sénat. Pire encore pour le sénateur, alors que « le monde de la santé crie qu’il n’a pas les moyens de remplir sa mission », « on réduit l’ONDAM de l’hôpital public en dessous de l’inflation et l’ONDAM des professionnels de ville à la moitié de l’inflation ». « Le monde de la santé est en rébellion. » Le 30 novembre, l’Assemblée débute l’ultime lecture du texte. Le lendemain, le gouvernement engage sa responsabilité sur la totalité du texte.
Le 2 décembre, le projet de loi (suite au rejet de la motion de censure déposée par l’alliance de gauche) est adopté en lecture définitive. Malgré un climat tendu, le ministre de la Santé ne manque pas de saluer un texte qui « traduit de manière concrète la démarche de refondation engagée ces derniers mois pour transformer en profondeur notre système de santé et préparer l’avenir ». Un avis qui ne fait pas l’unanimité puisque si ce projet de loi avait vocation à être un texte de « refondation de notre système de protection sociale », les acteurs voient surtout un document « sans souffle, sans ambition, déconnecté de l’urgence », affirme le député socialiste de l’Essonne, Jérôme Guedj.
Pour conclure, comme chaque année, l’on constate que le PLFSS ne permet aucune vision d’ensemble, qu’il n’est toujours pas « un levier porteur de priorités hiérarchisées et affichées et de réelle vision pour notre avenir collectif en santé18 ». L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ne paraît quant à lui « plus en mesure d’accompagner la transformation tout aussi nécessaire de notre système de santé19 ». Il ne permet ni de piloter ni de planifier l’investissement à long terme. Le cadre de régulation du système de santé actuel nous conduit in fine à nous focaliser sur des politiques de rabot budgétaire au détriment de réformes structurelles à moyen et long termes. Si cette politique du coup de rabot permet de respecter des objectifs macroéconomiques, elle rend cependant impossible toute stratégie d’avenir. Un nouveau modèle qui accompagne les réorganisations nécessaires et détermine une véritable stratégie d’investissement de long terme doit par conséquent être envisagé. Il y va de la pérennité de notre modèle social. Plus encore à l’heure où les défis en matière de santé et de Protection sociale sont immenses.
1 Initialement fixé à 6,8 milliards avant amendements.
2 18 milliards environ de déficit en 2022 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
3 Avis du Haut Conseil des finances publiques sur le PLFSS 2023.
4 Sécurité sociale 2022 – Cour des comptes.
5 Budget de la Sécu : le ministre François Braun mise sur la « prévention » et la « lutte contre les déserts médicaux » – Public Sénat.
6 Communiqué de presse de la FHF du 29 septembre 2022.
7 Accès aux soins : rétablir l’équité territoriale face aux déserts médicaux – Vie publique.
8 Étude réalisée par Iqvia France parue dans L’Express : « Déserts médicaux : d’ici à cinq ans, 27 millions de Français privés de généraliste ? ».
9 Choix de spécialité : tops et flops des internes en 2022 – Le Quotidien du médecin.
10 CNAM, améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance maladie pour 2023, juillet 2022.
11 Remédier aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques – les dossiers de la DREES n° 89 – décembre 2021.
12 Dépistage du cancer colorectal : une participation encore trop faible, l’INCa sensibilise – ONCORIF.
13 Gratuité de la « pilule du lendemain » : la mesure coûtera 16 millions d’euros par an à l’Assurance maladie – La Tribune.
14 Le 49-3, une arme qui n’a plus été utilisée depuis trente ans sur un budget – La Croix.
15 Initialement prévu au 1er janvier 2022 et décalé au 1er janvier 2023 en raison de la crise sanitaire.
16 Tribune. Retraite complémentaire Agirc-Arrco : « Pourquoi casser un élément majeur du pacte social ? » Journal du Dimanche (JDD).
17 Bruno Retailleau.
18 PLFSS, CNR : le chemin escarpé vers la transformation – Lamine Gharbi.
19 Catherine Deroche et René-Paul Savary – rapport d’information sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.