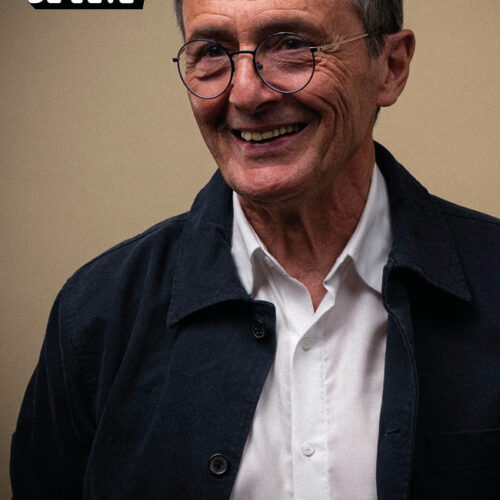Dossier

par
Anaïs Fossier
Directrice des études et des relations publiques du CRAPS
Le 4 décembre dernier – après un parcours tumultueux au Parlement marqué par de multiples recours à l’article 49.3 de la Constitution – le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2024 a été définitivement adopté. Comme l’année dernière, le Gouvernement qui n’a pas souhaité prendre le risque d’un vote défavorable a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale. Face à un hémicycle pratiquement vide, Élisabeth Borne, las, a défendu un budget « de 640 milliards d’euros pour notre modèle social, des moyens en hausse pour notre santé, pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ». Quelques jours plus tard, le 21, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de financement dont il avait été saisi par deux recours (étaient notamment en cause la trajectoire financière du texte, des prévisions économiques jugées insincères, et le creusement du déficit de la branche maladie) et a validé la quasi-intégralité de son contenu. La majorité des mesures figurant dans le projet de loi initial et des mesures adoptées lors de l’examen parlementaire ont donc été confirmées.
Publiée au journal officiel le 27 décembre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 s’inscrit pour l’essentiel dans une volonté affichée de redresser les comptes sociaux compte tenu des déficits attendus. Le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, a d’ailleurs rappelé – avec vigueur – lors des débats, la nécessité de « renforcer la pertinence des dépenses et la responsabilité de tous les acteurs face à la croissance des dépenses de santé ». Stéphanie Rist, rapporteur du texte, a quant à elle insisté sur le caractère transitoire de ce budget de « responsabilité » entre « sortie de crise et maîtrise des dépenses » rappelant que la situation des comptes sociaux, notamment celle de l’Assurance Maladie et de l’assurance vieillesse, « reste trop fragile à moyen terme ». Le redressement des comptes devra in fine « se poursuivre et exigera de nouveaux efforts ».
« Maîtriser les coûts sans pénaliser l’accès aux soins »
Les grands équilibres budgétaires sont donc actés : le budget de la Sécurité sociale pour 2024 est fixé à 640 milliards d’euros et le déficit toutes branches confondues devrait atteindre 10,5 milliards d’euros cette année. Après avoir atteint en 2020 un niveau inégalé avoisinant 40 milliards d’euros, le déficit de la Sécurité sociale s’est réduit les années suivantes, pour atteindre 19,6 milliards d’euros en 2022. En 2023, le déficit est resté élevé, à 8,8 milliards d’euros. Pour rappel, en 2018, le déficit de la Sécurité sociale était de 1,2 milliard d’euros. L’objectif national de dépenses d’Assurance Maladie, comme à l’habitude, très attendu est en hausse de 3,2 % et atteindra ainsi 254 milliards d’euros. Plus en détail, le sous-objectif des soins de ville est fixé à 3,5 %, tandis que celui des établissements de santé évolue à hauteur de 3,2 %. Les dépenses des établissements et services pour personnes âgées augmenteront de 4,6 %, et de 3,4 % pour les établissements pour personnes handicapées.
Bien qu’en deçà de l’inflation, le Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), Franck Devulder, a salué le « courage du Gouvernement » qui « pour une fois n’a pas pénalisé la médecine de ville par rapport à l’hôpital », insistant néanmoins sur les effets délétères induits par le déséquilibre entretenu pendant des années en défaveur de la médecine libérale. Constatant un financement largement insuffisant, les fédérations hospitalières n’ont en revanche pas tardé à monter au créneau. Une situation dramatique pour le Président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), Lamine Gharbi, qui induira « un plan d’économie majeur » que le secteur de l’hospitalisation ne pourra supporter. Le Président de la Fédération Hospitalière de France (FHF), Arnaud Robinet, considérant que « le temps où l’hôpital public était la variable d’ajustement des débats sur la dette doit s’arrêter » a quant à lui appelé à « ne surtout pas confondre la légitime recherche de plus d’efficacité avec une méthode du rabot dont l’hôpital est sorti essoré avant la pandémie » soulignant au passage que des leviers d’économies existent, notamment sur la prévention et la pertinence des soins. La Fédération a par ailleurs insisté sur la nécessité d’aller vers un pilotage pluriannuel de la santé, au moyen d’une loi de programmation.
Alors que l’Ondam reste, pour la deuxième année consécutive, inférieur à l’inflation, que la hausse naturelle des dépenses est estimée à 4,6 % et que l’urgence d’engager des transformations nécessaires semble avoir été ignorée, le Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), Éric Chenut, a de son côté vivement déploré une approche purement comptable sans cohérence avec les besoins, « ni en termes de niveaux de financements ni de renforcement des dispositifs indispensables pour assurer un accès aux soins de qualité et pour tous ». Finalement, « ce budget, s’il était respecté – ce qu’à peu près personne ne croit – financerait moins de soins en 2024 qu’en 2023 car le coût de ceux-ci progresse plus vite que l’enveloppe allouée »1. Nous sommes en résumé face à un budget « cadenassé par la contrainte budgétaire »2.
Le Gouvernement, qui n’a eu de cesse de réaffirmer sa volonté de « maîtriser les coûts sans pénaliser l’accès aux soins des Français » et de « poursuivre l’investissement et la transformation du système de santé » attend par ailleurs un effort d’économie sur les dépenses d’Assurance Maladie à hauteur de 3,5 milliards d’euros « non pas pour le principe mais au service de l’efficience » a toutefois assuré Aurélien Rousseau pendant les débats. Si cet effort est important a concédé le ministre et qu’il sera vraisemblablement « plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments » estime le Haut Conseil des Finances Publiques (HCPF), il n’est cependant « pas sans précédent ». Ces économies passeront par « un effort de maîtrise des dépenses de soins de ville et par une responsabilisation de l’ensemble des acteurs » a précisé le ministère des Comptes publics.
« Les déficits se creusent d’année en année »
Le 20 octobre, la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de financement pour 2024, dénonçant « l’insincérité » du budget et le manque de financement de la santé. Imperturbable, le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, à quant à lui salué un budget s’inscrivant « pleinement dans la trajectoire de maîtrise des dépenses publiques » du Gouvernement, sans être toutefois « synonyme d’austérité ». Cinq jours plus tard, sans surprise, Elisabeth Borne a engagé – quelques heures après le début des débats – comme c’était le cas lors de l’examen parlementaire du texte l’année dernière – , la responsabilité de son Gouvernement par le recours à l’article 49 alinéa 3 sur la partie recettes du projet de loi, reprochant comme à l’habitude le comportement des oppositions.
Le 30, puisqu’aucun groupe d’opposition n’a « souhaité dévier de sa ligne : refuser de voter un budget, quel qu’il soit », la Première ministre a engagé une nouvelle fois la responsabilité de son Gouvernement, sur la partie dépenses et sur l’ensemble du projet de budget. Dans la nuit du 15 au 16, le Sénat a rejeté la trajectoire du financement de la Sécurité sociale pour les années 2023-2027 au motif que le « trou de la sécu » devrait se creuser et atteindre 17 milliards d’euros en 2026 et 2027. Sans compter que les prévisions de recettes seraient d’après l’analyse du Haut Conseil, surestimées. Le message s’est voulu symbolique et politique. « Nous sommes avant tout dans une démarche politique parce que c’est le seul outil que nous avons ici » a d’ailleurs concédé Philippe Mouiller, Président de la commission des Affaires sociales. Elisabeth Doineau, s’est de son côté montrée sans concessions: « nous ne pouvons pas accepter que les déficits se creusent d’année en année ».
La sénatrice de la Mayenne a en effet vivement dénoncé « l’abandon affiché de l’objectif de retour de la Sécurité sociale à l’équilibre » ou même « d’un simple objectif de stabilisation du déficit ». Un constat qui révèle la volonté du Gouvernement « de financer durablement la santé par le déficit ce qui est vraiment contestable ». La sénatrice de la Charente-Maritime, Corinne Imbert, a, dans la même lignée, fustigé un « aveu d’impuissance du Gouvernement » qui a fait le choix de transmettre la dette aux générations futures et d’accroître l’endettement social « sans l’once d’un embarras ». Une allégation aussitôt réfutée par le ministre de la Santé et de la Prévention puisque si « la ligne de crête est ténue », Aurélien Rousseau a exprimé une vive opposition à « l’idée selon laquelle le gouvernement laisse filer les dépenses ». Une prise de position qui n’a pas convaincu.
La lecture de ce projet de loi a finalement révélé que la dette tend à devenir l’une des modalités de financement de notre modèle social. Elle a révélé qu’une stratégie structurelle de réduction des déficits fait cruellement défaut. Preuve en est : la France est l’un des pays européens dans lequel les dépenses de santé ont le plus progressé sans qu’y aient été menées des réformes structurelles suffisantes pour mieux dépenser.3 À l’heure où la question de l’équilibre des comptes sociaux est au cœur du débat public, il est utile de rappeler qu’un déficit permanent ne peut pas constituer une politique viable sur le long terme. Pour reprendre les mots de l’ancien député du Loiret, Jean-Pierre Door, il est fondamental et urgent de « renoncer au poison mortel de cette dette perpétuelle » qui remet en cause la pérennité de notre système de protection sociale, largement conditionnée par un retour à l’équilibre !
« La fraude est un poison pour notre contrat social »
Depuis une dizaine d’années, les dépenses relatives aux indemnités journalières ont connu une forte augmentation, de l’ordre de 3,8 % par an en moyenne. En 2022, l’indemnisation des arrêts de travail aura ainsi représenté un coût de 16 milliards d’euros (non liés au covid) pour l’Assurance Maladie. Une augmentation qui s’est de surcroît accompagnée d’une augmentation de la durée des arrêts de travail. Pour 2024, l’objectif pour l’Assurance Maladie vise à repérer et éviter 500 millions d’euros de dépenses frauduleuses (contre 316 millions en 2023). Conformément à la volonté gouvernementale, le texte s’inscrit dans une logique de lutte contre la fraude sociale – dont le montant est évalué entre 6 et 8 milliards d’euros – pour répondre à « un enjeu d’équilibre des comptes sociaux et d’équité entre les contribuables ». Le ministre de la Santé et de la Prévention a été clair : « la fraude est un poison pour notre contrat social, il faut la combattre ». Dans cette logique, le PLFSS prévoyait notamment la possibilité de suspendre automatiquement le versement des indemnités journalières suite à un contrôle d’un salarié en arrêt de travail à son domicile par un médecin mandaté par l’employeur, si l’arrêt de travail paraissait injustifié.
Le Conseil constitutionnel ayant cependant observé que cette mesure avait pour effet de « priver du versement des indemnités journalières à l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée » à censuré l’article.
En dépit de cette censure du Conseil constitutionnel, une réflexion de fond sur le sujet doit être initiée par les pouvoirs publics pour apporter des réponses adaptées. La protection sociale est un bien commun qui doit être protégé des abus et de la fraude. Pour autant, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’allongement de la vie professionnelle, on constate que les arrêts de travail des seniors s’avèrent plus couteux, avec en moyenne des arrêts « trois à quatre fois plus longs et des rémunérations indemnisées supérieures en fin de carrière ». Un phénomène qui s’amplifiera très certainement les prochaines années avec un départ d’âge légal à la retraite repoussé à 64 ans. Il s’y ajoute une forte croissance des arrêts de travail chez les jeunes, dont les causes restent pour l’instant partiellement identifiées. Si la lutte contre les abus est une nécessité que plus personne ne conteste, il est impératif de mettre en œuvre un véritable accompagnement des travailleurs en renforçant les mesures de prévention et en améliorant les conditions de travail. Le ministre de la Santé et de la Prévention a d’ailleurs lui même reconnu que limiter les arrêts de travail « renvoie aux questions de la qualité de vie au travail, de la prévention et de la reconversion professionnelle ».
Toujours dans une logique de lutte contre la fraude, la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation sera par ailleurs limitée et la prise en charge des prescriptions sera restreinte. Pour rappel, en 2021, 450 000 arrêts de travail (non liés au covid-19) ont été prescrits en téléconsultation. Sur la période de janvier à octobre 2022, la durée moyenne des arrêts prescrits était de 18 jours et 27 % des arrêts de travail issus d’une téléconsultation sont aujourd’hui prescrits par un médecin qui n’est pas le médecin traitant de l’assuré. Une consultation physique sera donc désormais obligatoire pour tous les arrêts de travail de plus de trois jours ou pour un renouvellement. Il est toutefois fait exception à cette règle lorsque « l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant (ou la sage-femme référente) ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir une prolongation de l’arrêt de travail ». La prise en charge des traitements, examens ou soins prescrits par l’Assurance Maladie obligatoire sera quant à elle désormais conditionnée à la réalisation d’une vidéotransmission ou d’un contact téléphonique avant toute prescription réalisée en téléconsultation ou en télésoin. L’ambition vise à remédier aux abus de certaines plateformes qui prescrivent des produits, prestations et actes aux patients, remboursés par l’Assurance Maladie après de simples réponses données à un questionnaire ou un outil de conversation en ligne sans consultation avec un médecin.
« Rendre irréversible le virage de la prévention »
Conformément à la volonté du ministre de la Santé « rendre irréversible le virage de la prévention », des rendez-vous de prévention à certains âges de la vie (18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans) visant entre autres à promouvoir l’information, l’éducation à la santé, la promotion de la santé et de la prévention seront mis en œuvre. L’objectif étant de réduire la morbidité et notamment la mortalité évitable, par la prévention des comportements à risque, des maladies non transmissibles et par la promotion d’actions de dépistage de certaines pathologies ou de facteurs de risque et l’amélioration de la couverture vaccinale. La mortalité évitable par une réduction des comportements à risque représente à titre d’exemple 30 % de la mortalité des personnes de moins de 65 ans.4 Déjà prévus par la LFSS 2023, notons tout de même que ces rendez-vous prévention en sont déjà, avant leur mise en œuvre, à leur deuxième modification législative, sans compter sur le manque de cohérence des discours sur le dispositif.
Toujours est-il que si l’ambition est louable, l’efficacité d’un tel dispositif risque de se heurter à une problématique de taille : l’adhésion. En effet, comment convaincre les Français de se rendre à ces rendez-vous alors que les programmes nationaux de prévention relatifs à la vaccination ou au dépistage n’ont pas les effets escomptés, comme le montre par exemple le faible taux de dépistage du cancer coloréctal (de l’ordre de 30 %), alors qu’il s’agit de la deuxième cause de décès par cancer chez l’homme ? Les modes d’organisation de ces rendez-vous, leur intégration dans le parcours de vie et de santé des personnes, les ressources mobilisées pour ce faire conditionneront par conséquent l’efficacité et l’efficience de cette mesure.
Par ailleurs, si « proposer des visites gratuites va dans le bon sens, nous en connaissons déjà les limites », explique le professeur Olivier Saint-Lary, Président du Collège National des Généralistes Enseignants, puisque « ce sont toujours les mêmes patients, autrement dit ceux déjà bien suivis, qui en tirent les bénéfices ». Sans actions ciblées et personnalisées, les messages de prévention ne bénéficieront donc que très peu aux personnes les plus éloignées du système. Un constat qui appelle a initier une véritable démarche d’ « aller vers » pour aller à leur rencontre au sein de leurs lieux de vie, avec un enjeu de repérage de ces personnes souvent « hors des radars », avant que les difficultés ne soient ancrées. Il est alors indispensable de promouvoir une approche populationnelle, afin que les personnes à risque puissent être repérées et que les inégalités face à la santé soient prises en compte. L’implication de structures de proximité, que ce soit des collectivités territoriales, des mutuelles ou des branches professionnelles, semble indispensable, comme l’a notamment montré l’expérience danoise.
Les politiques de santé territoriales doivent ainsi être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire, en prenant en compte les différences de contexte économique, géographique, démographique, environnemental, culturel et social. Les collectivités territoriales (et les acteurs des territoires) ont un rôle majeur à jouer en ayant dans leur périmètre de nombreux leviers qui concernent la santé et la prévention (écoles, transports, logement…). Nous savons en effet que le système de soins ne contribue que pour 20 % environ à la santé de la population, l’essentiel se passe donc ailleurs. Il s’agit in fine de rassembler tous les acteurs d’un territoire autour d’un objectif commun : la santé et le bien être de la population ! Plus largement, si la crise sanitaire a montré l’importance de « l’aller vers » dans une stratégie globale de prévention, elle a également révélé celle de la médiation en santé, notamment au travers des équipes de médiateurs de lutte anti-covid.
Toujours dans une démarche préventive, une campagne de vaccination doit être déployée dans tous les collèges pour les élèves en classe de 5e, afin de lutter contre le papillomavirus. L’enjeu est considérable puisque 1100 personnes décèdent chaque année de ce type de cancer évitable et que la France accuse un retard conséquent pour le dépistage (seulement 22 % des femmes éligibles – âgées de 30 à 59 ans – ont effectué un dépistage du cancer du col de l’utérus contre une moyenne de 50 % dans l’ensemble de l’Union européenne). En France, plus de 6 300 nouveaux cancers sont causés chaque année par les papillomavirus humains, dont environ 3 000 cancers du col de l’utérus.
Par ailleurs, alors que près de quatre millions de Françaises étaient victimes de précarité menstruelle en 2023 – un chiffre deux fois plus élevé qu’en 2021 – , le remboursement des protections menstruelles réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans ainsi que pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans limite d’âge, est prévu dès cette année. Les assurées de moins de 26 ans bénéficieront ainsi d’une prise en charge à hauteur de 60 % par l’Assurance Maladie et leur participation pourra être « compensée par les organismes complémentaires ». Les bénéficiaires de la C2S bénéficieront, quant à elles, d’une prise en charge à 100 %. Le coût de la mesure devrait représenter « 97 millions d’euros en 2025, et 56 millions d’euros en 2027 en fonction de l’évolution du taux de recours au dispositif et du renouvellement des produits ». Le droit à la prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie des préservatifs délivrés en pharmacie pour les moins de 26 ans est également acté. La mesure proposée devrait représenter « une dépense annuelle de 3,9 millions d’euros chaque année » et contribuera à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont la prévalence est particulièrement élevée chez les jeunes. Son inquiétante augmentation rappelle la nécessité de développer une véritable culture de la santé publique, mais aussi l’intérêt d’agir précocement en la matière, notamment à l’école.
Côté complémentaire santé solidaire, celle-ci sera désormais « automatiquement » attribuée aux bénéficiaires des minima sociaux. L’absence de couverture complémentaire santé impacte en effet fortement les allocataires qui sont davantage exposés au renoncement aux soins pour des raisons financières. Il s’agit notamment des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI). On constate par exemple que 13 % des bénéficiaires de l’AAH sont sans couverture complémentaire santé et supportent en conséquence des dépenses de soins très élevées (3 800 € par an en ville, 6 500 € à l’hôpital).
Plus largement, les expérimentations issues de l’article 51 qui au terme de leur évaluation auront démontré leur intérêt entreront dans le droit commun. L’article 51 qui a, pour rappel, introduit un dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations dérogatoires aux modes de tarification de droit commun, connait un bilan positif puisque « plus de 140 innovations ont été accompagnées au bénéfice d’1,2 million de patients ». Les premières évaluations des expérimentations révèlent en outre que « ces dispositifs innovants permettent d’accroître la qualité des parcours de soins mais aussi de fidéliser les professionnels en améliorant la satisfaction au travail ». Toutefois, pour les deux tiers des expérimentations ayant permis la mise en place de parcours coordonnés renforcés de prise en charge mobilisant plusieurs acteurs issus de différents secteurs, une modification du cadre législatif s’impose.
Un cadre générique permettant la mise en place de parcours coordonnés renforcés, au travers d’un financement collectif d’une équipe pour être adaptable aux besoins des patients et pouvant se déployer entre la ville, l’hôpital et le secteur médico‑social est donc prévu. Si le développement de nouvelles formes de parcours et de rémunération est « pertinent face aux nouvelles pathologies et au développement des affections de longue durée (ALD), l’impact monétaire pour les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM) n’a cependant pas encore été estimé par l’Assurance Maladie » a souligné le Centre Technique des Instituts de Prévoyance (CTIP) dans un communiqué, invitant alors les organismes complémentaires à la prudence, pour que cette « forfaitisation des dépenses » ne conduise pas aux même travers que pour « le forfait patientèle médecin traitant (FPMT) ». Le Président de la FNMF, Éric Chenut, s’est également montré vigilant sur les paiements au forfait, évoquant la « nécessité de bien répartir cette charge avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), de manière lisible, pour les assurés comme les professionnels » et appelant de ses voeux des forfaits « personnalisables, c’est-à-dire affectés à un patient puisqu’en tant qu’assurance complémentaire, il nous faut rattacher ce paiement par forfait à une personne. Ce n’est donc pas automatique ».
Pour conclure, si les mesures actées par le Gouvernement vont « dans le bon sens » elles manquent pour certains, d’ambition. Quels que soient leur intérêt ou leur pertinence, elles ne constituent pas à elles seules une politique de santé. Elles « ne suffisent pas à faire une politique de santé et de protection sociale à la hauteur ». Globalement, la priorisation des mesures opérées par le Gouvernement a de quoi « laisser songeur, voire dubitatif au regard des besoins de notre système de santé »5.
« Un chamboule-tout législatif »
Côté hôpital, le texte pose les premiers jalons de la réforme du financement à travers la fin du « tout T2A » au profit d’une « part structurante de la rémunération fondée sur des objectifs de santé publique négociés à l’échelle d’un territoire et permettant une rémunération effective des missions réalisées par chacun ». Malgré des effets positifs en termes de connaissance et de maîtrise des coûts, d’équité, de transparence dans la distribution des financements et d’efficience du système de santé, la T2A est contestée. Son financement, décorrélé des objectifs de santé publique, a en effet conduit à une recherche de rentabilité, parfois contraire à l’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins. Si des évolutions sont alors indispensables, notamment pour réduire une complexité technique, la Cour des comptes a rappelé la nécessité de ne pas « mettre à mal l’ensemble des avancées qui résultent de la mise en place de la T2A ». Lutter contre ses « effets négatifs » en la « diluant dans un financement où elle ne sera que marginale », serait, selon certains, dramatique puisque cela reviendrait à « condamner ce mode de financement qui donne aux établissements publics des règles analogues à celles des établissements privés, dans ce que les économistes appellent un « quasi-marché » c’est-à-dire un marché régulé par l’autorité administrative »6.
Le texte prévoit donc de revenir sur le caractère central de la tarification à l’activité dans le financement du champ « Médecine Chirurgie Obstétrique » (MCO) amplifiant ainsi la part de financement par dotations ou sans lien direct avec l’activité. L’objectif général vise à évoluer vers un modèle de financement permettant de valoriser les trois grandes catégories de soins suivants :
a) les soins répondant à des prises en charge « protocolées », organisées et standardisées, pour lesquels une tarification à l’activité est pertinente,
b) les soins aigus et les prises en charge spécifiques dont le coût est substantiellement indépendant du volume de l’activité réalisée, pour lesquels un financement mixte par dotation, en complément d’une part de tarification à l’activité, est le plus indiqué,
c) la prévention et la coordination des parcours des patients, relevant d’objectifs de santé publique qui peuvent être en partie propres à certains territoires, pour lesquels un financement par dotation apparait nécessaire.
Les établissements de santé seront ainsi financés selon trois compartiments : « financement à l’activité » ; « dotation relatives à des objectifs de santé publique » ; « dotation relatives à des missions spécifiques ». L’application du nouveau modèle de financement se fera à compter du 1er janvier 2025.
Si pour la sénatrice de la Charente Maritime, cette réforme est « attendue et, reconnaissons-le, nécessaire » d’autres appellent à la vigilance car, si « définir des dotations partant des besoins de santé est un très bon principe » « il faut absolument que le mème modèle s’applique à l’hôpital public comme au secteur privé, pour éviter un système à deux vitesse, délétère pour les patients et les soignants, comme nous l’avons connu dans les années 1970 » a vivement insisté Arnaud Robinet, Président de la FHF. La Cour des comptes a d’ailleurs souligné les inconvénients du système de « dotation globale forfaitaire », qui prévalait auparavant : « il ne récompensait pas les hôpitaux travaillant beaucoup et constituait une rente pour ceux travaillant peu ». Finalement, « le Gouvernement a réalisé ici une formidable opération de chamboule-tout législatif à droit quasi constant, dont la principale prouesse est d’avoir « rangé » en trois compartiments les modalités de financement du MCO ». La sénatrice a vivement reproché au Gouvernement de lancer des « chantiers techniques sans que la question des activités de maternité ou de pédiatrie, par exemple, soit arbitrée ». Pire encore, « pour une réforme du financement, aucune évaluation de l’impact financier n’est livrée ». « Cette improvisation n’est pas raisonnable ». « Nous devons refuser de jouer avec l’hôpital pour répondre à un effet d’annonce ! » a martelé Corinne Imbert, qui avait préconisé lors de l’examen du texte de reporter cette réforme au 1er janvier 2028 et de prévoir une expérimentation de trois ans, à partir de 2025.
Pour conclure, comme chaque année, on constate que le PLFSS n’a pas permis de vision d’ensemble réclamée à corps et à cris par les acteurs de la santé, qu’il n’est pas « un levier porteur de priorités hiérarchisées et affichées et de réelle vision pour notre avenir collectif en santé ». En matière de santé, les choix ne peuvent pas se faire à l’aune d’une année budgétaire. Le vote tel qu’il est proposé ne permet pas de faire les choix de moyen et long termes qui s’imposent. Le cadre actuel, avec des ajustements permanents à la marge ne permet plus d’avoir une capacité de projection pour les acteurs, ni d’adapter le système de santé au regard des besoins. Il n’est donc pas possible d’avoir des débats de fond sur les orientations que nous souhaitons donner à notre système de santé. Si l’examen des projets de lois apporte chaque année son lots de mesures, le cadre de régulation du système de santé actuel nous conduit donc à nous focaliser sur des politiques de rabot budgétaire rendant impossible toute stratégie d’avenir. Un nouveau modèle qui accompagnerait les réorganisations nécessaires et déterminerait une véritable stratégie d’investissement de long terme (qui ne se résume pas à un catalogue de priorités) semble indispensable. Il y va de la pérennité de notre modèle social.
L’instauration d’une loi de programmation pluriannuelle en santé – à l’instar des lois de programmation militaires – régulièrement évoquée pourrait par exemple permettre de « s’accorder sur les grandes réformes à mener pour notre système de santé » et d’apporter la visibilité à long terme réclamée par les acteurs de terrain. Ce nouveau cadre permettrait d’identifier les risques et les opportunités à long terme, de définir une stratégie à court et moyen termes et d’en déduire le cadre financier qui s’impose. En résumé, le changement de paradigme qui nous oblige suppose de porter une vision stratégique et politique pour notre système de santé et d’en tirer dans un second temps les conséquences en termes d’organisation et de moyens !
________________________________________________________________________________
1. Sénateur de Paris, Bernard Jomier
2. Jerome Guedj, député de l’Essonne
3. Cour des comptes
4. Stratégie nationale de santé – 2023/2033
5. Corinne Imbert, lors des débats sur le projet de loi
6. Veronique Guillotin, Sénatrice de la Meurthe-et-Moselle
– DP – Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2024
– Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale n°1682 pour 2024
– Avis de la Commission des finances sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2024 – (n°1682). (M. Michel Lauzzana).