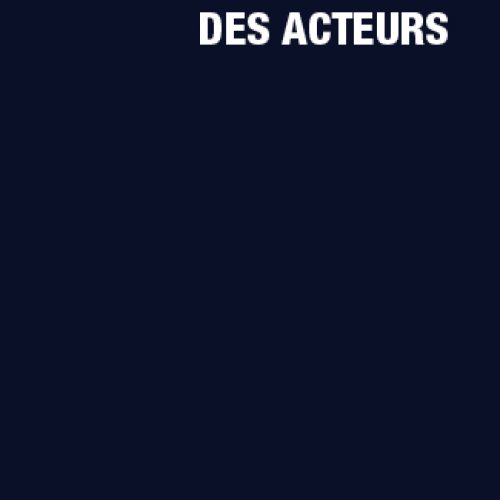Tribune

Par
Élise Debiès
Avocate au barreau de Paris
Les besoins financiers de la protection sociale croissent à mesure du vieillissement de la population. Son financement s’appuie sur la croissance, qui va potentiellement à l’encontre de la transition écologique. La loi de finances pour 2025 porte de timides mesures comme les prémices d’un Fonds territorial climat. Mais avec la division par deux du Fonds vert, de MaPrimeRénov et du Fonds économie circulaire, l’État se désengage des réponses aux enjeux de la transition écologique et la facture citoyenne de l’inaction continue augmenter chaque année (dépenses causées par les catastrophes naturelles, coûts de la dépollution, coûts de l’adaptation au dérèglement climatique, etc.). Le PLFSS 2025 définitivement adopté par le Sénat le 17 février après un parcours chaotique ne fait pas mieux, pour ne pas dire bien pire… Si beaucoup a déjà été fait, beaucoup reste à faire. L’impact de la dégradation environnementale sur la santé commence à être pris en compte, mesuré et pris en charge par l’assurance maladie, dans une vision « one health ». Même si santé, santé au travail et retraite sont intrinsèquement liées et progressivement mieux intégrées, les conséquences de la transition écologique sur l’emploi et donc sur les retraites semblent moins anticipées.
Face à la crise énergétique de 2021-2023, la protection sociale a su réagir par des revalorisations anticipées de prestations, le chèque énergie, un « bouclier tarifaire » à large spectre sur les prix énergétiques. Au cours de l’histoire de la protection sociale, des fonds (victimes de l’amiante), des caisses (mines) ont été créés pour répondre à des risques provoqués par des mutations ou dérèglements écologiques spécifiques. On a donc des outils qui ont un coût. Selon l’OFCE, l’empreinte carbone des 10 % des ménages français les plus aisés est deux fois plus importante que celle des 10 % les plus pauvres1. Alors que leur impact est plus faible, les ménages les plus modestes subissent une surexposition aux pollutions, nuisances ou accidents sur les lieux de travail et sur les lieux de vie proches de zones industrielles. Les comportements des entreprises et des consommateurs évoluent doucement, mais l’action individuelle n’est pas suffisante : c’est la coopération collective qui est en jeu. Mais l’heure est au recul sur les engagements pour la transition écologique.
Pourtant, face au désengagement des États-Unis, l’Europe doit assumer son rôle de leader dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par les accords de Paris, avec une ambition de 0 émission en 2050 et une réduction des gaz à effet de serre de 55 % en 2030. Ces réductions nécessaires ont forcément des incidences sur la croissance, sur les emplois et donc directement sur les retraites (le financement de celles d’aujourd’hui et la constitution des droits des retraités de demain). Une étude réalisée pour l’Institut syndical européen, l’ETUI, retient un impact de la « transition bas carbone » sur la trajectoire de croissance de l’ordre de -0,1 à -0,5 point de PIB annuel dans les pays européens2. Cet impact n’est pas nul, mais il reste très inférieur aux coûts économiques potentiels des dommages environnementaux. L’inaction, l’absence de régulation européenne prônée par certains, peut coûter très cher. Et pas seulement financièrement : en santé et en vies humaines aussi.
Les restructurations d’activité et d’emploi liées à la transition écologique vont frapper particulièrement les travailleurs les moins qualifiés, qui risquent de connaître un déclassement professionnel ou un chômage durable. Le système de retraite français sait mettre en œuvre des amortisseurs pour les perdants temporaires et persistants des transitions sur le terrain de l’emploi (meilleure prise en compte des carrières hachées, protections minimales pour les fins de carrières au chômage). La transition écologique s’opère en outre dans un contexte de mutation technologique et du travail ainsi que de vieillissement de la population, qui obligent à se pencher de façon systémique sur la question. Faire face solidairement à la transition écologique devrait être la boussole des réformes actuelles, y compris celle du financement de la Sécurité sociale, en France et en Europe. Après cette nouvelle loi de financement de la sécurité sociale perdue pour ouvrir la voie vers une transition écologique solidaire, comment reprendre la main, chacun à notre niveau d’engagement collectif et individuel, pour affronter ensemble les conséquences sur la Protection sociale du risque climatique et écologique ?
Sources :
1. Revue de l’OFCE, « Qui émet du CO2 ? Panorama critique des inégalités écologiques en France », 2020.
2. ETUI, « Une transition socialement juste grâce au green deal européen ? », 2020.