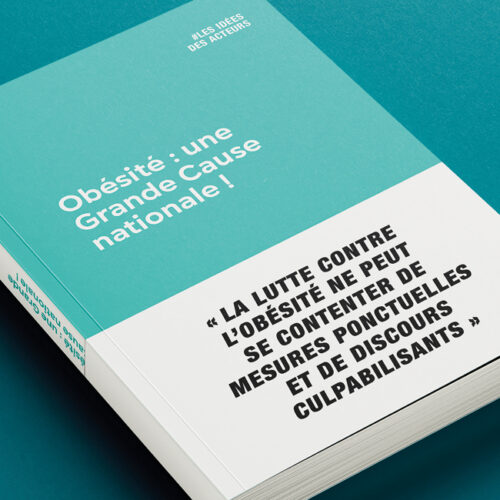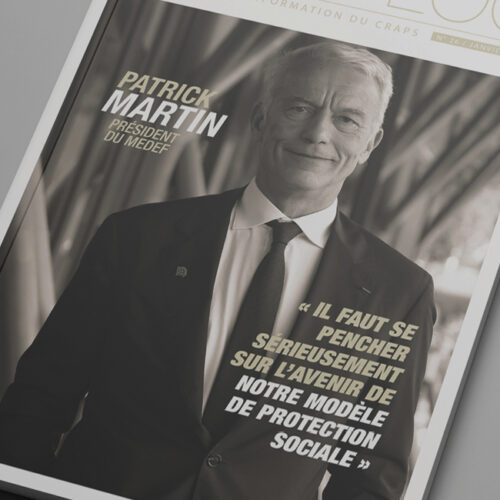Tribune
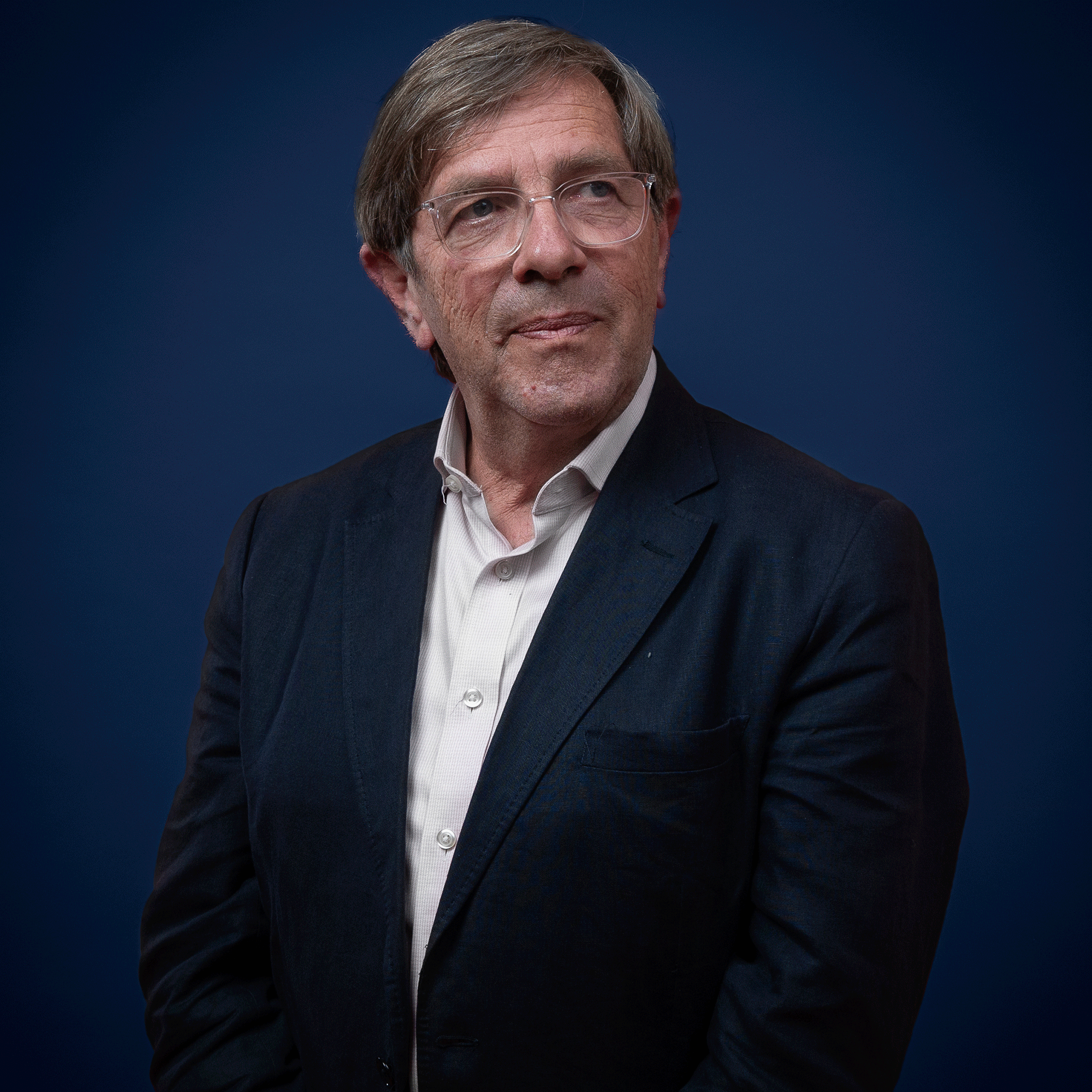
Par
Michel Monier
Ancien Directeur général adjoint de l’UNEDIC et membre du Think Tank CRAPS
Le second rapport de la Cour des comptes sur le financement des retraites, « Impacts du système de retraites sur la compétitivité et l’emploi », n’y coupe pas. La dépense de retraite rapportée au PIB revient comme l’un des déterminants majeurs de la nécessaire réforme du système de retraite. Avec l’équivalent de 13,5% de PIB (rapport de la Cour) l’évidence s’impose et la comparaison avec la situation des retraites en Allemagne ajoute la part de benchmark habituelle. Si cette évidence du poids des retraites sur l’économie était mal perçue, les perspectives démographiques et les conséquences du poids des retraites sur la compétitivité de l’économie et sur l’emploi finissent de convaincre.
Dépense de retraite : dépasser le ratio dépenses/PIB.
On pourrait objecter que le pourcentage d’équivalent PIB consacré aux retraites omet de faire la différence, entre les financements par les cotisations sociales et par l’impôt, et donc entre les prestations d’assurance-retraite et les prestations de solidarité. Prélèvements obligatoires obligent cette différence subtile est réputée hors de propos. On pourrait observer que la différence des ratios entre la France (13,5%) et l’Allemagne (9,7%) résulte d’abord d’un différence de PIB : on produit moins ici (44 690 USD par habitant- Banque mondiale- 2023) que de l’autre côté du Rhin (54 342 USD) et voir, en conséquence que la dépense en euros est en France inférieure à celle de l’Allemagne (405 Mds€ et 418 Mds€ respectivement). Il demeure que, par retraité la France dépense plus que l’Allemagne.
Cette sur-dépense est-elle prodigalité indue ? Non, elle s’explique par (1) les taux de cotisation (28,6% du salaire ici, 18,6% là-bas) et en conséquence (2) par un taux de remplacement de 65% (donnée COR) et de l’ordre de 44% en Allemagne. Il en résulte que le retraité Français perçoit une retraite (moyenne) de 1626 €, le retraité Allemand de 1236 €. Il faut alors préciser qu’en Allemagne une part seulement de la pension de retraite est incluse dans l’assiette imposable ce qui a pour effet d’exonérer d’impôt l’immense majorité des retraités1 : l’écart vrai entre la retraite moyenne française et allemande est l’écart net d’impôt. L’écart vrai n’est pas de 30% mais de l’ordre de 17%, un écart qui s’explique par la différence des taux de cotisations.
Comparer les rapports de la dépense de retraite au PIB c’est donc comparer deux systèmes qui ne sont pas comparables. Si les politiques publiques sont friandes de ces comparaisons il nous faut le secours des historiens de la protection sociale pour nous dire comment, quand et pourquoi des deux systèmes jumeaux bismarckiens l’un s’est fait enfant prodigue quand l’autre se présente tout de vertu.
Dérive française, frugalité allemande.
L’habituelle comparaison France -Allemagne centrée sur les dépenses sociales ne pousse pas jusqu’au benchmark de l’organisation de l’appareil de l’État. L’on nous dit la comparaison impossible entre un État fédéral et un État centralisé, une fonction publique « démembrée » pour l’un, une fonction publique sous statut pour l’autre, des périmètres différents… Et donc ? Comparer le ratio fonction publique/PIB est-ce moins orthodoxe que comparer les dépenses sociales/PIB ?
Les 3 fonctions publiques françaises comptent (source Fipéco) « 5 694 000 personnes à la fin de 2022. Ils étaient supérieurs de 1 055 000 à ceux de la fin de 1997, ce qui correspond à une hausse de 23 % alors que les effectifs dans le secteur privé ont augmenté de 18 % et la population de 14 % sur cette période » ; en Allemagne la fonction publique ce sont 5 269 970 fonctionnaires, employés et militaires2. L’écart est faible mais ces effectifs servent 68 millions d’administrés ici, 83 millions en Allemagne. Traduit en dépense de rémunération sur PIB c’est, pour la France, 12,9% (chiffre Banque de France-2015) et 7,5%3 pour l’Allemagne L’écart de 5 points s’est réduit depuis 2015.
Si l’on s’en tient à une logique arithmétique on s’interrogera sur ce qui fait que 12-13% de PIB en dépense publique pour les rémunérations n’ont pas le même intérêt à être réformés que 13-14% de dépense pour les retraites.
Si une marge existe pour économiser sur la dépense de retraite, une marge significative existe aussi pour réduire le poids des moyens de l’action publique sur le PIB.
Sortir de la logique comptable.
Économiser, ou taxer, ce n’est pas réformer. Le système de production devra, toujours, permettre aux actifs de financer leur juste rémunération et leur protection sociale et de financer aussi le social intergénérationnel. Quelles que soient les réformes-aménagements du système dit par répartition « La seule manière de transférer des ressources vers l’avenir, en effet, consiste à accumuler du capital productif sous toutes ses formes — capital de production direct (machines), connaissances, formation, équipements publics — ce qui permettra aux générations futures de produire, pour elles-mêmes et pour leurs parents retraités, des biens en quantité telle que le « partage », : inévitable, soit celui de l’abondance et non celui de la pénurie4 ». Reste la question de l’effectif public, qui alimente -quelle que soit la convention comptable- la charge des retraites. Peut-on arriver à un équilibre des retraites si les régimes publics restent joints au système dit par répartition ?
Sources :
1. « Le mode actuel d’imposition des pensions (Ertraganteilsbesteuerung) conduit à n’inclure dans l’assiette soumise au prélèvement qu’une partie de la pension. Ce mode d’imposition repose sur l’idée, qu’au moment du départ à la retraite un capital (fictif) a été accumulé par le paiement des cotisations au cours de la phase d’activité, et qu’il est ensuite consommé sous la forme d’une rente viagère, pendant la durée de vie moyenne encore à courir. Seuls les « intérêts », soit encore « la part imputable au rendement » (ce dernier étant fixé par la loi) sont imposables. Concrètement, cela a pour effet d’exonérer d’impôt direct l’immense majorité des pensions vieillesse » – revue OFCE N°68
2. Selon le ministère fédéral de l’intérieur et des collectivités territoriales « la fonction publique emploie désormais 1 763 735 fonctionnaires et 3 337 145 autres employés aux niveaux fédéral, étatique et local, ainsi que 169 090 militaires au niveau fédéral ».
3. Ou, en taux d’emploi 22% de l’emploi total en France et 11% en Allemagne.
4. Jean-Paul Fitoussi, in « Introduction au dossier sur les retraites : un débat pour progresser », revue OFCE N°68.