Dossier
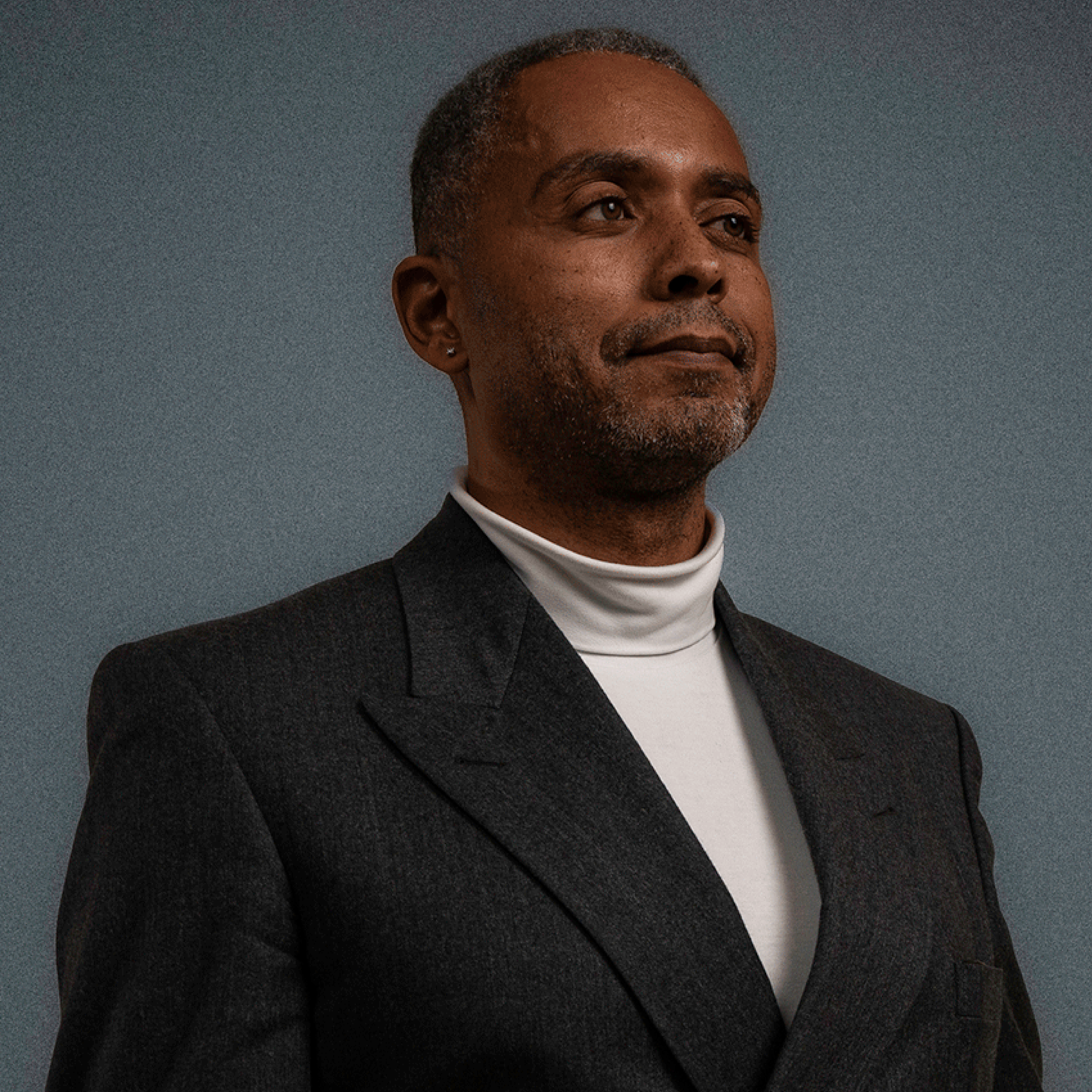
par
Éric Chenut
Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française
La soutenabilité de notre système de protection sociale est menacée par les déficits et les nouveaux défis qui émergent. Son mode et ses outils de financement sont-ils adaptés pour répondre aux attentes et besoins de la population ? Plus largement, l’allégement voire l’exonération des cotisations sociales, l’économie de services aux emplois peu qualifiés, le chômage et les emplois de courte durée, l’émergence d’emplois non salariés, de facto peu socialisés et donc peu financeurs, ont notamment conduit à un financement de la protection sociale de plus en plus fiscalisé. Cette évolution vous inquiète-t-elle ?
L’évolution démographique, marquée par une hausse de l’espérance de vie – après avoir connu une période de stagnation liée à la crise Covid – témoigne de l’efficacité de nos politiques publiques malgré les tensions que connaît notre système de santé et un investissement moindre dans la prévention par rapport à certains pays. Tout ne va donc pas aussi mal que nous pourrions le penser. Cette évolution démographique, bien que très positive, implique cependant que nous réinterrogions notre modèle de financement puisque nous savons que les besoins de santé vont continuer d’augmenter de manière substantielle et bien plus rapidement que ces quinze ou vingt dernières années. Ce n’est pas un problème en soi, mais ce constat doit nous conduire à initier rapidement un débat et à décider collectivement si nous souhaitons ou non consacrer plus de ressources à notre protection sociale, que ce soit à travers les cotisations sociales, fiscales ou nos cotisations mutualisées. Si nous ne le souhaitons pas, il faudra toutefois avoir le courage de dire que nous devrons renoncer à certaines protections. Ce débat est éminemment politique, il s’agit de faire un choix de société sur la manière dont nous vivons avec les autres, les uns pour les autres. Une fois qu’un consensus sur le sujet sera trouvé, nous pourrons ensuite réfléchir au niveau de ressources que nous souhaitons affecter et à la façon de le répartir (quelle part entre cotisations sociales et fiscales ? Quels revenus mobiliser au regard notamment des nouvelles formes de travail, de l’ubérisation, etc. ?). Nous savons par ailleurs que le financement de la dépendance et des nouvelles vulnérabilités mobilisera une large partie des ressources disponibles et nécessitera in fine de trouver de nouvelles sources de financement. Initier un débat sur la fiscalité des grosses successions – qui ne concernent pas la majorité des Français – bien qu’impopulaire, me semble utile. Une quote-part pourrait, par exemple, financer une partie de la dépendance. Plus largement, notre système a été mis en place à une époque où il y avait six actifs pour un retraité. Nous en percevons bien les limites avec 1,7 actif pour un retraité aujourd’hui et potentiellement 1,2 demain. Nous devons donc repenser son financement, mais aussi son pilotage. Si tel n’est pas le cas, l’attrition des recettes à l’aune des besoins sera problématique et le déficit permanent – hors période de crise et d’investissement – n’est pas une option souhaitable.
La politique de rabot budgétaire déployée ces dernières années pour tenter de remettre le système de santé « à flot », rend en privilégiant le « saupoudrage », l’investissement difficile voire impossible. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est-il un outil de nature à permettre une véritable vision pour notre avenir collectif en santé ? Faut-il changer de logiciel en la matière ?
Nous aurons toujours besoin d’un outil budgétaire annuel, mais nous devons le resituer dans une approche pluriannuelle, a minima à l’échelle d’une législature. En matière de protection sociale et de santé, les choix ne peuvent pas se faire sur un temps court, à l’aune d’une année budgétaire. Le PLFSS ne permet pas de faire les choix de moyen et long termes, voire de très long terme qui s’imposent. Il nous contraint et ne permet plus d’avoir une vision des enjeux du système de santé, de l’organisation de la protection sociale. Le cadre actuel d’annuité budgétaire avec des ajustements permanents à la marge ne permet plus d’avoir une capacité de projection pour les acteurs, ni d’adapter le système de santé, compte tenu des besoins. Le projet de loi élaboré par les directions des administrations arrive dans la sphère publique en septembre et les délais d’adoption sont extrêmement restreints. Il n’est donc pas possible d’avoir des débats de fond et de nous questionner sur les orientations que nous souhaitons donner à notre système de santé. Je considère plus largement que ces choix ne devraient pas se réduire à un vote de la majorité des parlementaires, à 51 %, et encore moins en ayant recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution puisqu’ils relèvent du bien commun et qu’ils doivent dans cette logique dépasser tous les clivages. J’appelle ainsi de mes vœux une société dans laquelle la démocratie sociale et la démocratie en santé permettent l’expression et le dialogue entre les parties prenantes (associations de patients, usagers, organisations de santé, financeurs, etc.) pour faire émerger des compromis et, a minima, éclairer la décision politique.
Les pouvoirs publics imposent aux complémentaires santé un encadrement toujours plus contraint avec une mise en concurrence aveugle des acteurs, au détriment des capacités de mutualisation. Les procès d’intention autour des frais de gestion sont quant à eux de plus en plus nombreux. Un nouveau processus d’étatisation est-il à craindre ?
À force de ne jamais dire aux citoyens de combien évolue la dépense de santé chaque année ni combien ils doivent payer, ils finissent par penser que la santé est gratuite et que les augmentations de leurs cotisations sont illégitimes. En 20 ans, les dépenses de santé ont considérablement évolué. Nos cotisations ont, quant à elles, connu une évolution pratiquement équivalente. Cette augmentation est toutefois particulièrement visible dans notre secteur puisque nous adressons à nos adhérents des appels à cotisations et qu’en tant qu’entreprises non lucratives, nous ne pouvons pas être en déficit, ce qui implique une recherche constante d’équilibre. Nous sommes par ailleurs fortement impactés et cadenassés par le contrat solidaire et responsable qui devait, à l’origine, être centré sur les soins essentiels, mais qui chaque année nous a contraints à une prise en charge de plus en plus large. Si ce contrat offre un haut niveau de définition des couvertures et permet donc d’accroître la mutualisation, il engendre également un très haut niveau de coûts. En ce qui concerne la « grande sécu », je ne pense pas que cette idée soit définitivement enterrée. Si cette dernière venait à se concrétiser, quelles que soient ses modalités de mise en œuvre, cela reviendrait à, petit à petit, annihiler les capacités, la latitude, les libertés des acteurs et des complémentaires qui ne seront plus en mesure par exemple de financer des actions de prévention. Cela aurait in fine un impact délétère sur les capacités d’innovation et d’investissement. Je pense que ce n’est pas dans l’intérêt des Français.
Les critiques relatives aux frais ou coûts de gestion sont par ailleurs régulières et je ne comprends vraiment pas ce procès. Si nous pouvions les baisser, nous le ferions. Notre préoccupation est évidemment de limiter les augmentations lorsque cela est possible. Si les tarifs augmentent, c’est parce que nous n’avons pas d’autres alternatives si nous voulons continuer à couvrir les dépenses de santé de nos adhérents. On nous demande aujourd’hui d’intégrer dans les coûts de gestion un certain nombre de prestations en nature et services qui relèvent du conseil et de la proximité. Cela concerne les réseaux conventionnés, qui permettent pourtant d’éviter d’augmenter significativement les cotisations. Cela concerne aussi le tiers payant qui permet aux citoyens de ne pas avancer un certain nombre de dépenses et d’éviter de renoncer aux soins. Cela concerne enfin la prévention, l’action sociale et l’accompagnement humain et social via nos centres d’appels situés sur le territoire national et en proximité, au sein des agences et espaces d’accueil physique sur l’ensemble du territoire. Nous constatons également un renchérissement des coûts de gestion lié à un certain nombre d’obligations prudentielles et réglementaires qui nous sont imposées réforme après réforme (souvent sans études d’impact sérieuses). Quand des économies sont réalisées, elles sont absorbées par la mise en œuvre d’une nouvelle réforme, qui s’avère souvent coûteuse pour une efficacité parfois contestable. Certaines décisions comme la mise en place de la résiliation infra-annuelle contribuent à augmenter les coûts notamment liés au système d’information. Nous pouvons probablement trouver des sources d’économies, à condition qu’un véritable choc de simplification des nomenclatures de l’Assurance maladie pour les soins de ville comme à l’hôpital qui impliquent d’importants coûts de gestion pour l’Assurance maladie comme pour nous soit engagé.
Les problématiques d’accès aux soins s’accentuent dans de nombreux territoires et constituent une préoccupation majeure pour les Français. En sachant que la pénurie de médecins est amenée à durer, est-il possible de favoriser et renforcer l’accès aux soins ?
Nous ne pouvons pas nier les difficultés qui existent, mais nous avons aussi des solutions à notre portée. Nous devons, en revanche, avoir un discours de vérité et ne pas laisser penser que chacun aura un médecin traitant comme on avait un médecin de famille et que toute prise en charge passera par le médecin qui orientera le patient dans le système. Mettre en place des assistants médicaux est utile, mais cela ne suffira pas. Nous ne pouvons plus aujourd’hui raisonner en termes de nombre de médecins puisque le temps médical a diminué. Malgré la mise en œuvre du numerus apertus, nous ne retrouverons ni le nombre de médecins dont nous disposions en 2020, ni le temps médical avant 2040. Nous ne pouvons plus raisonner comme nous le faisons actuellement puisque, d’ici là, la population va continuer de vieillir et que les besoins en santé vont continuer d’augmenter. Nous serons toujours, au regard de ce constat, en pénurie. Il nous faut alors initier une profonde révolution culturelle en la matière que ce soit pour les assurés sociaux ou les professionnels de santé (médicaux et paramédicaux). Ce changement de paradigme implique une nouvelle organisation du système. Nous devons désormais raisonner en équipe de soins traitante (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme, etc.) selon les profils des patients si nous voulons faire davantage de prévention, pour que les gens vivent mieux, le plus longtemps possible sans incapacité ou invalidité. Dans certains cas, à l’instar de l’accompagnement des personnes diabétiques, le recours à un infirmier s’avère par exemple plus efficace sur le long terme. Il faut donc redéfinir les missions des médecins, en s’appuyant davantage sur les paramédicaux pour concentrer le temps médical sur les activités à forte valeur ajoutée. Tout le monde serait gagnant et les patients seraient mieux suivis.
Si nous demandons aux paramédicaux de faire davantage, cela suppose cependant que les modes et niveaux de rémunérations soient réinterrogés. C’est pour cela que nous appelons à des négociations interprofessionnelles avant d’engager les négociations conventionnelles. Je pense avant tout qu’il faut « réarmer » les soins de ville en nous posant les questions qui s’imposent notamment sur l’organisation de la permanence des soins (nous sommes passés en vingt ans de 73 % à 38 % de médecins qui s’inscrivent dans celle-ci). Si nous ne voulons pas que la population se rende aux urgences encore faut-il qu’elle ait accès aux soins en semaine, le soir et le week-end. L’hôpital a besoin de moyens, il a besoin de se transformer, mais si une large part des moyens est concentrée sur les urgences parce que les personnes ne sont pas prises en charge en ville, cela ne sera pas suffisant. Je préfère que l’on rémunère bien la permanence des soins plutôt que de payer le passage aux urgences. Finalement la question que nous devons nous poser c’est : quelles réponses apporte-t-on pour garantir un service public de santé de bon niveau ? En ce qui concerne la remise en cause de la liberté d’installation des médecins régulièrement évoquée, je pense que ce n’est pas la solution. Il fallait probablement se poser la question il y a 30 ans. Je crois beaucoup plus à la coopération, à la concertation et à l’utilisation des nouvelles technologies qu’à la coercition qui sera probablement contre-productive.
Alors que nous n’avons jamais consacré autant d’argent à la protection sociale, les inégalités se creusent, comme en témoignent les 10 ans d’espérance de vie sUpplémentaires en faveur des plus favorisés sur un rayon inférieur à 100 kilomètres en région parisienne. Notre système ne semble in fine plus en mesure de lutter efficacement contre les inégalités sociales et territoriales. Quelle en est votre analyse ? Comment notre système de protection sociale peut-il être plus efficace ?
La première des inégalités – avant celles de revenus et de patrimoine – concerne l’espérance de vie. Avec 6,4 ans d’écart d’espérance de vie entre un cadre et un ouvrier et 13 ans entre les 5 % les plus riches et les 5 % les plus pauvres, le sujet devrait être politique. Ce n’est pourtant pratiquement jamais évoqué dans le débat public. Les raisons de ces écarts tiennent à des déterminants de santé bien connus : rémunération, niveau de formation, conditions de travail, logement, lieu de vie, exposition aux polluants, attrition des services publics dans certains territoires, etc. Ce constat nous invite à nous interroger sur le partage de la valeur et les niveaux de rémunération. Nous devons plus largement infléchir le recul des services publics de proximité en réinvestissant et en réinstaurant l’égalité républicaine en mettant davantage de moyens là où les difficultés sont les plus importantes. Dans cette logique, il s’agit de fixer des objectifs et de vérifier s’ils sont atteints. Si ce n’est pas le cas, il faut en analyser les raisons pour tenter d’inverser la tendance. Nous devons nous améliorer en matière d’évaluation, ce n’est pas quelque chose que nous savons bien faire pour le moment. C’est une nécessité si nous voulons voir les inégalités se réduire. Agir sur les inégalités suppose plus globalement d’investir sur l’ensemble des politiques publiques ayant une incidence sur les déterminants de santé, mais aussi en personnalisant les messages de prévention et les actions à mener. Il ne s’agit évidemment pas de segmenter ou d’individualiser, mais bien d’adapter les actions à mener et les prises en charge selon les besoins des personnes. On constate en effet que nous mettons en place d’excellents dispositifs de prévention sans toutefois déployer une véritable action d’« aller vers » pour toucher les populations les plus éloignées du système de santé. Ce sont donc toujours les moins informés qui bénéficient le moins de ces dispositifs. Le taux d’accès aux dépistages dans notre pays (15 à 25 points derrière les pays d’Europe du Nord) met d’ailleurs en exergue des disparités considérables selon les catégories sociales. Si nous ne nous donnons pas les moyens de faire de la prévention personnalisée, les inégalités se creuseront toujours davantage.
32 % des Français risqueraient de tomber sous le seuil de pauvreté s’ils devaient renoncer à 3 mois de leur revenu. Peut-on accepter que 7 actifs sur 10 ne soient pas ou mal couverts face aux risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès ? Comment changer de paradigme en la matière ?
Selon leur situation professionnelle et leur statut : salarié du privé, agent de la fonction publique, travailleur nonsalarié, cadre ou non-cadre, en recherche d’emploi, les actifs ne bénéficient pas des mêmes niveaux de protections organisés, structurés et mutualisés. Contrairement à la complémentaire santé devenue obligatoire, la prévoyance complémentaire ne s’est pas généralisée chez les employeurs du privé. Seuls les cadres bénéficient d’une obligation de protection, principalement sur le risque décès. La population est donc inégalement couverte. La prévoyance n’est par ailleurs pas toujours bien appréhendée puisque l’incapacité, l’invalidité et le décès sont des situations dans lesquelles personne ne souhaite se projeter. Pour l’invalidité et l’incapacité, nous pensons que cela concernera les autres ou que la probabilité que le risque survienne est faible. Nous avons beaucoup de mal à nous préparer à ces évènements parfois tragiques. Pourtant, les enjeux sont importants, tant sur le plan de la santé que sur le plan matériel. Nous devons parler davantage de prévoyance et changer de paradigme. J’appelle donc de mes vœux une généralisation de la couverture prévoyance. S’il n’y a pas d’obligation de se couvrir pour ces risques, les citoyens ne le feront pas instinctivement alors que peu d’entre eux disposent d’une épargne leur permettant de faire face à un accident grave. La vocation première de la protection sociale est de se prémunir d’un aléa, il ne s’agit pas seulement de solvabiliser les dépenses !
La prévention est l’objet d’incantations politiques régulières. Force est cependant de constater qu’elle ne constitue toujours pas le cœur du système. Alors que la santé d’une population tient majoritairement à des déterminants extérieurs au système de soins, comment peut-on développer une véritable politique de santé publique et notamment de prévention ? Le concept “one health” est -il une utopie de plus ?
Notre système de santé est confronté à de multiples enjeux tels que le vieillissement, l’augmentation des maladies chroniques, ou encore la santé environnementale. Nous devons appréhender la santé différemment en investissant urgemment dans tous les domaines de la prévention. Le virage préventif que nous appelons de nos vœux, pour être efficace, doit partir des déterminants de santé et mobiliser les politiques publiques ayant un impact en la matière : éducation, culture, transports, logement, etc. Les collectivités locales et les acteurs des territoires en disposant des leviers d’action nécessaires ont à cet égard un rôle central à jouer. L’État devrait quant à lui se cantonner à la définition des grands objectifs et au cadrage des concertations. Les citoyens doivent en outre pouvoir prendre part aux réflexions. Cela signifie qu’il faut réfléchir au niveau territorial, par une approche populationnelle. Si nous faisons de la prévention « à l’insu du plein gré » des personnes, cela ne fonctionnera pas. Je ne suis donc pas un adepte du « nudge » très infantilisant. Il est selon moi préférable d’accompagner les citoyens pour leur permettre de faire des choix éclairés. La nécessité de déployer une approche intégrée de la santé publique, animale et environnementale de la santé n’est plus à démontrer. Nous savons que l’environnement a un impact sur la santé et inversement, comme en témoignent les trajectoires du réchauffement climatique et les potentielles épidémies à venir. Nous devons être volontaristes en la matière, voir quels sont les choix et les alternatives possibles. Cela nous oblige à la responsabilisation. Par ailleurs, les impacts du réchauffement climatique vont accroître les migrations de population, ce qui induit de repenser en profondeur notre prisme d’analyse sur ces questions et enjeux. Les questions de transition écologique et de décarbonation concernent bien le Monde dans sa globalité, nous devons collectivement changer de logique et rapidement puisqu’il y va de la survie de l’Humanité. Renoncer à certains de nos modes de vie apparaît alors dérisoire.
Les projections démographiques prévoient une augmentation de l’espérance de vie des personnes âgées. Espérance de vie qui devrait cependant aller de pair avec l’augmentation d’incapacités, impliquant une augmentation des besoins de santé. Quel regard portez-vous sur la place des personnes âgées dans la société ? Comment appréhendez-vous le concept du “bien vieillir” ?
Le regard de la société sur les personnes âgées doit changer. Nous devons sortir du dogme du jeunisme et nous questionner sur la manière dont nous faisons fonctionner les solidarités dans notre pays. Nous posons souvent la question des solidarités des jeunes envers les plus âgés, mais beaucoup moins en sens inverse. La question du partage du patrimoine est donc globalement absente des débats. Pourtant, alors que l’on hérite en moyenne à 63 ans, âge auquel sa vie n’est plus à construire, la concentration du patrimoine devrait nous interroger. Une société civilisée se mesure plus largement à son aptitude et son appétence à prendre soin des plus vulnérables. Nous devons donc réfléchir aux moyens qu’il faudrait déployer pour permettre à nos aînés de mener leur projet de vie dans de bonnes conditions chez elles lorsque cela est possible. Leur permettre de rester à domicile suppose cependant de disposer des ressources humaines nécessaires, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le virage domiciliaire ne pourra donc pas être pris si nous ne l’anticipons pas suffisamment. Par ailleurs, tout comme pour le handicap, si nous invisibilisons les personnes âgées parce que l’espace public n’est pas pensé pour qu’elles puissent s’y rendre cela ne fonctionnera pas. Nous devons donc revoir l’aménagement urbain (bancs, trottoirs accessibles, etc.). Nous aurions tout à gagner puisque si les personnes âgées sont en mesure de sortir et de se déplacer, elles continueront d’entretenir leur capacité musculaire et seront moins sujettes aux chutes. C’est un cercle vertueux.
Les débats – nombreux – ces dernières années concernant le droit de mourir, l’euthanasie active ou le suicide assisté, témoignent d’une préoccupation sociale forte. Quel devrait être selon vous le rôle de la société dans la réflexion sur la fin de vie ? Considérez-vous que le dispositif législatif actuel soit suffisant ?
Il y a deux sujets sur la fin de vie, celui de l’accès aux soins palliatifs et celui de l’accompagnement actif à mourir, suicide assisté ou euthanasie selon les situations. En ce qui concerne les soins palliatifs, on constate que dans un certain nombre de territoires la population n’y a pas accès faute d’offre. Chacun devrait pouvoir accéder aux soins palliatifs lorsqu’il est à l’hôpital, dans un établissement médicosocial ou à domicile. Nous devons garantir l’accessibilité à ces soins partout et pour tous. Cela suppose un plan de rattrapage en termes de moyens, de formation et de recrutement. Concernant l’accompagnement actif à mourir, je suis à titre personnel un militant de la liberté et de l’émancipation. Je ne vois pas à quel titre nous devrions priver les personnes de ce choix. Je considère qu’il doit appartenir à chacun, pour ce moment ultime, dans le fort de ses convictions intimes, de décider sereinement de sa fin de vie. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il ne faut pas mettre de garde-fous et être très attentif aux questions éthiques et déontologiques que cela pose. D’un point de vue législatif, la loi Claeys-Léonetti est une avancée importante, mais elle ne permet pas de répondre à toutes les situations. Certaines pathologies ne donnent pas droit à la sédation définitive et continue et cela ne permet donc pas à certains d’être accompagnés alors qu’ils savent que l’issue est inéluctable et ne bénéficient donc pas du droit à la dignité. De façon plus générale, la société doit se réinterroger sur ces questions. La mort est avant tout un moment humain qui fait partie de notre vie auquel nous ne pourrons pas échapper. À cet égard, il me semble important de parler dans les familles des directives anticipées pour dire ce que l’on souhaiterait lorsque le moment sera venu. Aujourd’hui, un peu comme c’est le cas de la naissance que nous avons hyper médicalisée, beaucoup plus que dans d’autres pays, nous sommes en train de médicaliser la mort. Cela doit nous questionner sur la société que nous voulons et sur la manière dont nous souhaitons traiter ces moments spécifiques de la vie que sont l’arrivée et le départ.
Le PLFSS 2024 a été adopté le 4 décembre dernier, sans vote, en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Comme l’année dernière, le Gouvernement a voulu éviter le risque d’un vote défavorable. Quel regard portez-vous sur l’usage de ce processus de « blocage politique » ? Plus largement, les alertes démocratiques renouvelées sont inquiétantes comme le montrent la progression de l’abstention et la défiance toujours plus vive à l’égard des décideurs. Peut-on encore inverser la tendance ?
Nous ne cultivons pas suffisamment la démocratie sociale et ne débattons pas comme il se devrait avec la société, que ce soit les partenaires sociaux ou les associations de patients. Si nous ne tenons pas compte de la parole des corps intermédiaires alors que le dialogue social fonctionne, cela conduit à des situations de blocage où les gens se replient sur des certitudes et sont en proie à la radicalité. La démocratie ne se vit pas en pointillé, c’est un processus continu. Si nous voulons que les parlementaires puissent faire leur travail et trouver des compromis, il faut avant tout que la démocratie ne soit pas une confrontation permanente de radicalités exacerbées où chacun campe sur ses positions. La démocratie, c’est respecter que ce ne soient pas nos convictions qui aient convaincu, c’est faire un pas vers l’autre. Force est de constater cependant qu’elle recule dans notre pays et que les citoyens sont trop peu associés aux décisions qui sont prises. Être citoyen dans une démocratie ce n’est pas seulement voter une fois tous les cinq ans. C’est s’intéresser à la chose publique, c’est jouer son rôle de vigie dans la cité. C’est pour cela que miser sur la démocratie en santé est un impératif. Nous devons permettre aux citoyens de s’élever vers la pleine citoyenneté pour faire des choix éclairés. Je suis un fervent défenseur de la démocratie pleine et entière, dans laquelle on responsabilise la population, dans laquelle on leur explique l’utilité et le sens de leurs cotisations, dans laquelle nous arrivons à trouver un juste équilibre entre solidarité et responsabilité individuelle et collective permettant l’émergence de comportements vertueux pour soi, et pour les autres. C’est parce que notre pacte républicain repose sur cet équilibre subtil que la population doit contribuer aux réflexions et aux débats sur notre modèle social. Toutefois, progressivement, réformes après réformes, nous glissons vers une étatisation de notre système de protection sociale et nous laissons in fine le citoyen seul face à l’État pour sa protection sociale. Je pense que c’est une erreur profonde. La façon d’élaborer les réflexions et d’éclairer le débat doit être repensée pour permettre d’avoir différentes options et alternatives, pour que nous fassions des choix éclairés. C’est à travers la pratique démocratique que l’on redonnera du sens et du souffle. C’est une urgence si nous ne voulons pas arriver à des catastrophes démocratiques dans quelques années.
L’opprobre jeté sur les corps intermédiaires, le faible taux de syndicalisation et une administration forte ont muselé d’une certaine manière le dialogue social, tant par le rétrécissement de son champ d’action que par les processus de sa saisine. Or, notre démocratie a besoin de ces corps intermédiaires, de cette représentation des assurés sociaux. La protection sociale est-elle toujours l’étendard de notre cohésion sociale ? Comment redonner un souffle nouveau à notre Pacte social ?
Nous ne pouvons pas revenir à ce que nous avons construit en 1944, aux « jours heureux », puisque le contexte a changé, mais nous devons continuer à cultiver la philosophie qui a inspiré la création de notre modèle social pour que chacun puisse entreprendre, mener sa vie personnelle, familiale et professionnelle… tout en étant assuré que la collectivité, constituée de tous les citoyens, dans leur multiplicité et leur pluralité, jouera son rôle de filet de sécurité si un aléa survient. Nous consentons collectivement à être là pour les autres, à nous protéger mutuellement pour ne laisser personne au bord de la route. C’est ce que je trouve exceptionnel dans la promesse de la protection sociale, dont l’existence est conditionnée par la cohésion sociale. Nous devons avec l’appui des associations, des mutuelles, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des partenaires sociaux, des syndicats comme patronat et des politiques, restaurer une forme de citoyenneté sociale. Comme je le disais, le contexte a changé. Cela suppose de faire des choix en matière de prise en charge et de composer avec les marges de manœuvre dont nous disposons actuellement au regard des besoins et des pathologies qui émergent et qui nécessitent des moyens importants. Nous devons donc réinterroger nos priorités au regard des défis qui s’annoncent. Cependant, ces priorités ne doivent pas être décrétées. Il faut en débattre collectivement et expliquer aux citoyens que nous devons faire des choix et définir ce qui devrait ou non relever de la socialisation. C’est comme cela, selon moi, que nous pourrons réenchanter la démocratie. C’est d’ailleurs dans cette optique que je suis engagé avec la Mutualité Française au sein du Pacte du pouvoir de vivre. Plus la population comprendra la complexité des sujets, des enjeux et se posera les bonnes questions, plus il sera aisé de lui donner envie de recréer des liens de solidarité. Les citoyens subiront de surcroît moins violemment les grandes transformations dans lesquelles nous sommes engagés. Nous pourrons de cette manière recultiver la nuance qui nous fait défaut et permettre l’émergence de consensus. La démocratie se délite lorsque nous n’arrivons plus à la cultiver. Il faut veiller à ne jamais oublier que la démocratie est un horizon que nous devons améliorer en permanence. Ce n’est jamais acquis !
Propos recueillis par Fabien Brisard, Directeur général, et Anaïs Fossier, Directrice des études et des relations publiques du CRAPS.



