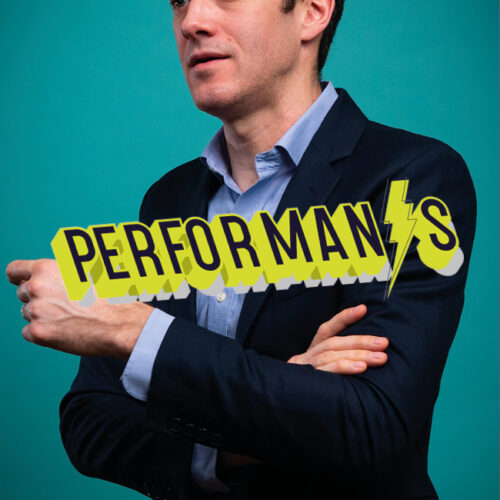Tribune
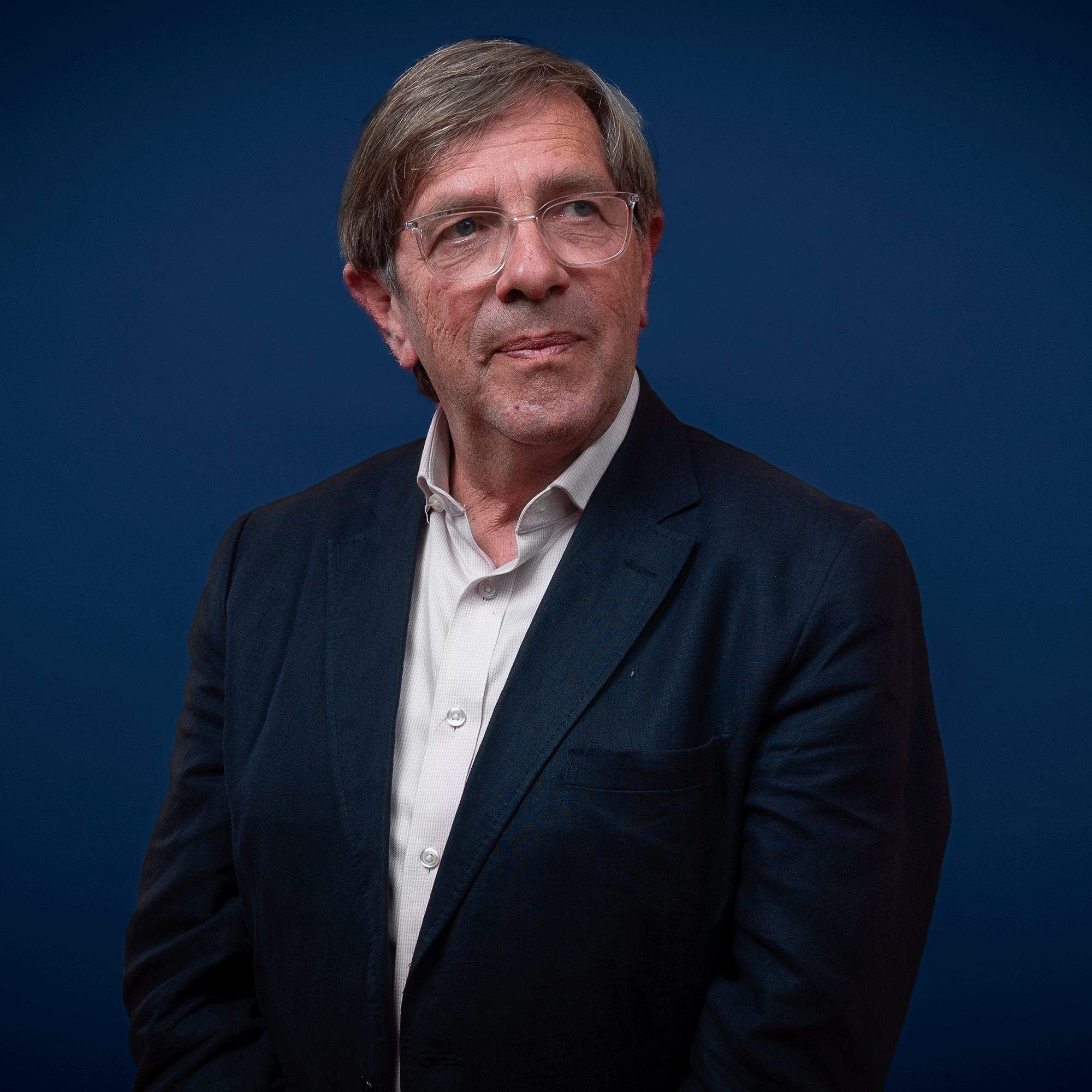
Par
Michel Monier
Ancien Directeur général adjoint de l’Unédic et membre du Think Tank CRAPS
Quand il s’agit des comptes publics, la transparence est un impératif de justice sociale. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre s’est efforcé à cet exercice et a commandé un audit flash à la Cour des comptes qui doit livrer, dans un délai bref, « un constat et des chiffres indiscutables ».
L’enjeu de la remise en chantier de la réforme des retraites impose de ne pas s’interroger sur l’ardente nécessité de cette mission alors que la Cour rend, chaque année, un rapport sur les finances de la Sécurité sociale et qu’elle certifie les comptes de l’État : ses travaux ne sont-ils pas, déjà, « un constat et des chiffres indiscutables » ? Pour donner toutes ses chances à la négociation des partenaires sociaux, cet audit flash est bien venu, il est comme un nouveau départ.
Pour respecter le délai bref, la Cour pourra reprendre ce qu’elle écrivait dans son rapport de mai 2023 consacré à la Sécurité sociale :
« Le déficit de la branche vieillesse s’accroît, passant de 2,7 Md€ en 2021 à 3,8 Md€ en 2022. Il est toutefois réduit d’un tiers par le FSV. Il s’explique par les déficits du régime général pour 2,9 Md€ (contre 1,1 Md€ en 2021) et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour 1,8 Md€ (contre 1,2 Md€ en 2021). Les autres régimes sont, en règle générale, en excédent ou à l’équilibre. Cet équilibre est toutefois obtenu, pour le régime de la fonction publique d’État et pour un certain nombre de régimes spéciaux, par le versement de contributions de l’employeur ou de subventions de l’État d’un montant total de 51,3 Md€ en 2022, qui ont tendance à augmenter (+ 1,7 Md€ par rapport à 2021) ».
Elle pourra, ensuite, redire ce qu’elle disait dans sa communication aux Commissions des affaires sociales, en octobre 2024 :
Par rapport à 2023 (10,8 Md€), le déficit [des régimes obligatoires de base] « augmente de 7,2 Md€. Cette dégradation est imputable, dans des proportions équivalentes, à la branche vieillesse (3,7 Md€ hors fonds de solidarité vieillesse, FSV), dont le déficit atteindrait 5,5 Md€, y compris le solde du FSV, et à la branche maladie (3,5 Md€), dont le déficit, déjà très élevé, continuerait à progresser pour atteindre 14,6 Md€ ».
Elle pourra, encore, rappeler ce qu’elle écrivait dans son rapport 2022 (Chapitre II Le financement de la sécurité sociale : des règles à clarifier et à stabiliser) :
« Pour la branche vieillesse, dont les prestations sont essentiellement contributives, la part des cotisations apparaît au contraire faible (54,8 % en pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale en 2021, soit 142,8 Md€, et 64,9 % pour le régime général). Elle traduit notamment la compensation de la réduction générale de cotisations par l’affectation d’impôts et de taxes (8,4 % des recettes) et certaines particularités du financement de cette branche : la contribution de l’État employeur au régime de retraite des fonctionnaires (16 %), les subventions d’équilibre de l’État aux régimes spéciaux de retraite de la SNCF, de la RATP, des mines et des marins (2,9 %) et les transferts reçus de la branche famille et du FSV en vue du financement de droits et de prestations de retraite à caractère non contributif (11,1 %) ».
Avec ces trois rappels, l’audit flash est bien avancé, le constat et les chiffres sont indiscutables : (1) la branche vieillesse est sur une trajectoire de déficit structurel, (2) l’État contribue par des subventions d’équilibre à financer le déséquilibre créé par l’État-employeur, (3) les cotisations sociales-vieillesse représentent – encore – 64,9% du financement du régime général qui, sans la réduction générale des cotisations, serait financé à hauteur de 73%, (4) déficit et source de financement « par cotisations ou par impôts [sont] en cohérence incertaine avec les prestations servies » (Cour des comptes 2022). Voilà de quoi nourrir la négociation des partenaires sociaux pour une réforme « d’équilibre et de meilleure justice ».
Cette remise en chantier de la réforme pour une meilleure justice devrait viser à rendre plus juste et plus équilibré le financement des divers régimes obligatoires de base. Quand les réductions de cotisations sociales sont financées par l’impôt et les taxes, l’allègement du coût du travail alourdit l’impôt et les taxes. Le « tour de magie » n’est que transfert, l’allégement du coût du travail réduit le pouvoir d’achat. Quand les cotisations ne suffisent plus pour financer les droits contributifs, pourquoi ne pas s’interroger sur le financement par le régime général de prestations non contributives : quelle est la part du déficit de la branche vieillesse qui résulte de charges qui relèvent de la branche famille ? Faire ce « ménage » entre les branches de la Sécurité sociale, ce serait faire un pas vers plus de justice pour les financeurs que sont les salariés et les employeurs. La même question peut être posée pour les trimestres CNAV validés au titre des périodes de chômage. L’audit flash de la Cour posera-t-il ces questions ? Aborder ainsi la question, c’est indiquer la voie pour réduire le déficit de financement contributif et dire quel est l’état réel du régime par répartition.
L’audit flash de la Cour posera, c’est certain, de façon claire et indiscutable, le cas des retraites publiques et des régimes spéciaux. Si l’État subventionne le déficit résultant de … l’État-employeur, il le fait par l’impôt et les taxes qui sont payées par les salariés, les employeurs et par la dette (elle-même financée par les salariés et les employeurs). Le salarié du privé s’acquitte donc de ses cotisations vieillesse et finance aussi les retraites publiques (et la rémunération des agents publics) : en faisant, sous le terme de « prélèvements obligatoires », un tout des impôts, taxes et cotisations sociales, le système est brouillé, illisible. Une réforme « équilibrée et de meilleure justice » doit prendre en compte ce constat ; elle ne peut pas être, une fois encore, articulée autour des seuls paramètres d’âge et de niveaux des contributions et prestations de façon uniforme.
Pour engager une vraie réforme des retraites « équilibrée et de meilleure justice », il faut accepter des mesures différenciées par régimes pour les faire converger. Ce qui devrait être fait pour l’équilibre des retraites des salariés du privé est de moindre ampleur que ce qui devrait être fait pour les retraites publiques et les régimes spéciaux. Le « constat et les chiffres indiscutables » diront-ils les modalités différentes entre les secteurs public et privé s’agissant de la période de référence (dont on sait les pratiques consistant en l’octroi d’un échelon de rémunération supérieur dans les six derniers mois) ? les différences, encore, quant aux pensions de réversion, sans condition ni d’âge ni de ressources pour les pensions publiques ? Ces questions ne sont pas différentes de l’ambition portée par le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus » (octobre 2024). Conforter l’égalité des citoyens « devant » la retraite ne peut pas ne pas être un des objectifs de la remise en chantier.
Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires dépasse le cadre fixé au « conclave » des partenaires sociaux, mais deux des nombreux sujets dont il traite ont lien direct avec la remise en chantier à laquelle ils doivent s’atteler. Le premier est celui de l’abattement de 10 % pour frais professionnels qui s’applique sur les pensions de retraites. Le second est relatif aux « compléments de salaires » qui échappent à l’impôt et aux cotisations sociales. Supprimer cet abattement et rendre cotisables certains compléments de salaires, voilà des ressources nouvelles qui peuvent être légitimes. Le souci de conforter l’égalité des citoyens devant les prélèvements obligatoires devrait faire poser d’autres questions, mais ce n’est pas là l’objet… encore que. La remise en chantier n’est-elle pas l’opportunité de mettre sur la table la question d’une contribution sociale retraite qui, à l’instar de la CSG activité dont sont redevables les seuls « gens du privé », pour financer l’indemnisation du chômage, serait appliquée aux rémunérations publiques au titre de la solidarité inter-régime ?
Le diable est, dit-on, dans les détails ; l’impératif de transparence pour davantage de justice impose de le débusquer et de lever le voile sur tout ce qui pèse sur la dépense de retraite et sur son financement, de lever le voile sur les différences de financement et de prestations entre les divers régimes. L’opportunité est donnée, sinon de trouver « à bref délai » toutes les solutions, au moins de poser toutes les questions pour poser dans une trajectoire « systémique » le pilotage des réformes successives que le système devra accepter.