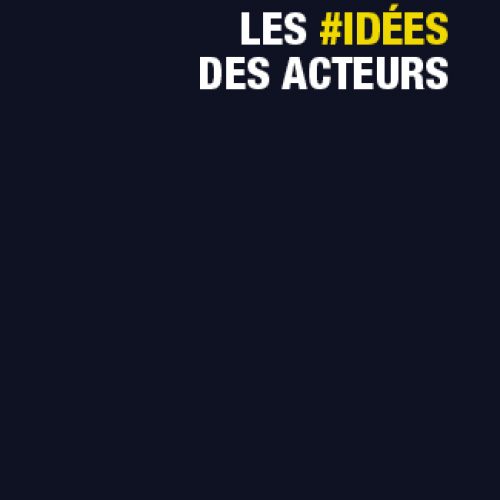Tribune
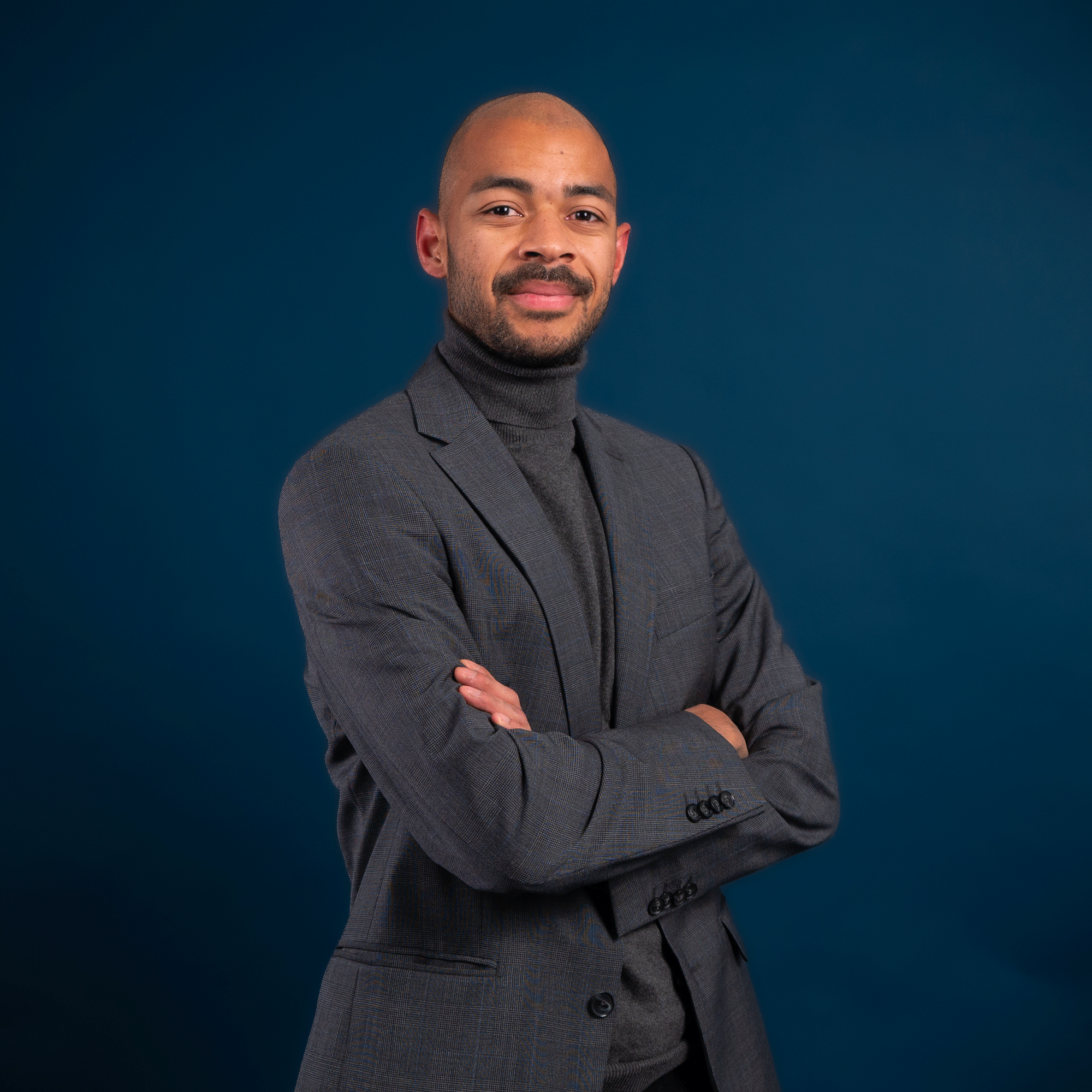
Par
Guillaume Moukala Same
Chargé d’études économiques pour le cabinet Astérès
La France dispose d’un système de cartographie et de suivi des maladies chroniques très élaboré et précis. L’Assurance maladie met en ligne chaque année des statistiques sur la prévalence et les coûts des 57 pathologies, traitements ou prises en charge « les plus fréquentes sur le territoire ». Pourtant, l’obésité, qui est reconnue par l’OMS depuis 1997 comme une maladie chronique non transmissible (au même titre que les maladies coronariennes ou le cancer par exemple), qui concerne en France plus de 8 millions de personnes (soit 17 % de la population adulte), ne fait pas partie de ce dispositif. À titre d’exemple, dans les statistiques de l’Assurance maladie, une consultation de suivi de l’obésité entre dans la très large catégorie des « consommations courantes de soins », à défaut d’une catégorie « soins de ville » pour les patients atteints d’obésité. Force est de constater que la reconnaissance de l’obésité comme véritable pathologie ne constitue pas une réalité statistique en France.
C’est une limite à laquelle Asterès, cabinet au sein duquel je travaille, s’est heurté en se penchant sur le coût de l’obésité en France. Deux types de coût étaient pris en compte : le coût relatif à la prise en charge de l’obésité, que l’on peut nommer « coût direct », et le coût relatif à la prise en charge des pathologies attribuables à l’obésité, que l’on peut appeler « coût indirect ». La méthode utilisée pour l’estimation du coût indirect consistait à s’appuyer sur la notion épidémiologique de « fraction attribuable du risque » pour déterminer, parmi les nombreux cas de 14 pathologies chroniques associées à l’obésité, lesquels auraient pu être évités si le patient n’avait pas été en situation d’obésité.
In fine, Asterès a estimé le coût de l’obésité en France à près de 11 Mds€ en 2020 (dont plus de 8 Mds€ pour l’Assurance maladie, hors coût de la COVID-19), soit environ 1 240 € par individu en situation d’obésité, en moyenne. Ce coût est composé pour 98 % de coûts indirects et pour seulement 2 % de coûts directs. Ce rapport entre le coût direct et le coût indirect ne reflète pas le poids réel des complications de l’obésité, mais simplement le manque de données sur sa prise en charge, dont le coût se limite dans cette étude aux chirurgies bariatriques.
Cette absence de l’obésité dans les statistiques de l’Assurance maladie est symptomatique d’un manque de considération et de prise en charge. Intégrer l’obésité à la cartographie des pathologies les plus courantes inciterait, à l’inverse, à une meilleure prise en charge. En effet, le suivi statistique de l’obésité implique le diagnostic et donc le dépistage de la maladie, ce qui n’est pas systématiquement le cas sur le terrain. Bien que le dépistage ne soit pas toujours suivi d’une prise en charge rigoureuse, il en demeure une condition essentielle. Cela n’implique pas nécessairement d’intégrer l’obésité au dispositif d’affection de longue durée (ALD), puisque plusieurs traitements et prises en charge courantes ne sont pas des ALD, notamment les traitements psychotropes (antidépresseurs, neuroleptiques, anxiolytiques, hypnotiques), et sont pourtant suivis et analysés par l’Assurance maladie avec la même précision que les ALD. Le débat sur la reconnaissance de l’obésité comme une ALD reste toutefois ouvert.
La réflexion sur la prise en charge de l’obésité est urgente, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans le débat national sur le virage préventif de notre système de santé. En effet, une prise en charge efficace de l’obésité ne constitue pas un coût, mais un investissement sur le long terme. À titre d’exemple, Vivons en forme (Vif), un programme déployé par l’association Fédérons les Villes dans plus de 260 villes, dont le but est de prévenir le surpoids et l’obésité chez l’enfant, permettrait d’éviter sur le long terme plus de 17 500 cas d’obésité d’après les travaux d’Asterès – dans l’hypothèse où les effets du programme se maintiennent dans le temps. Asterès estime, à partir des données disponibles publiquement, que chaque euro dépensé annuellement dans ce programme génère treize euros d’économies nettes par an sur le long terme. Voilà donc un exemple d’action de prévention bénéfique sur le plan sanitaire et rentable sur le plan économique. In fine, augmenter le coût direct de l’obésité (la prise en charge), c’est investir dans la baisse drastique du coût indirect (les complications de l’obésité).